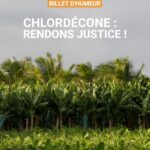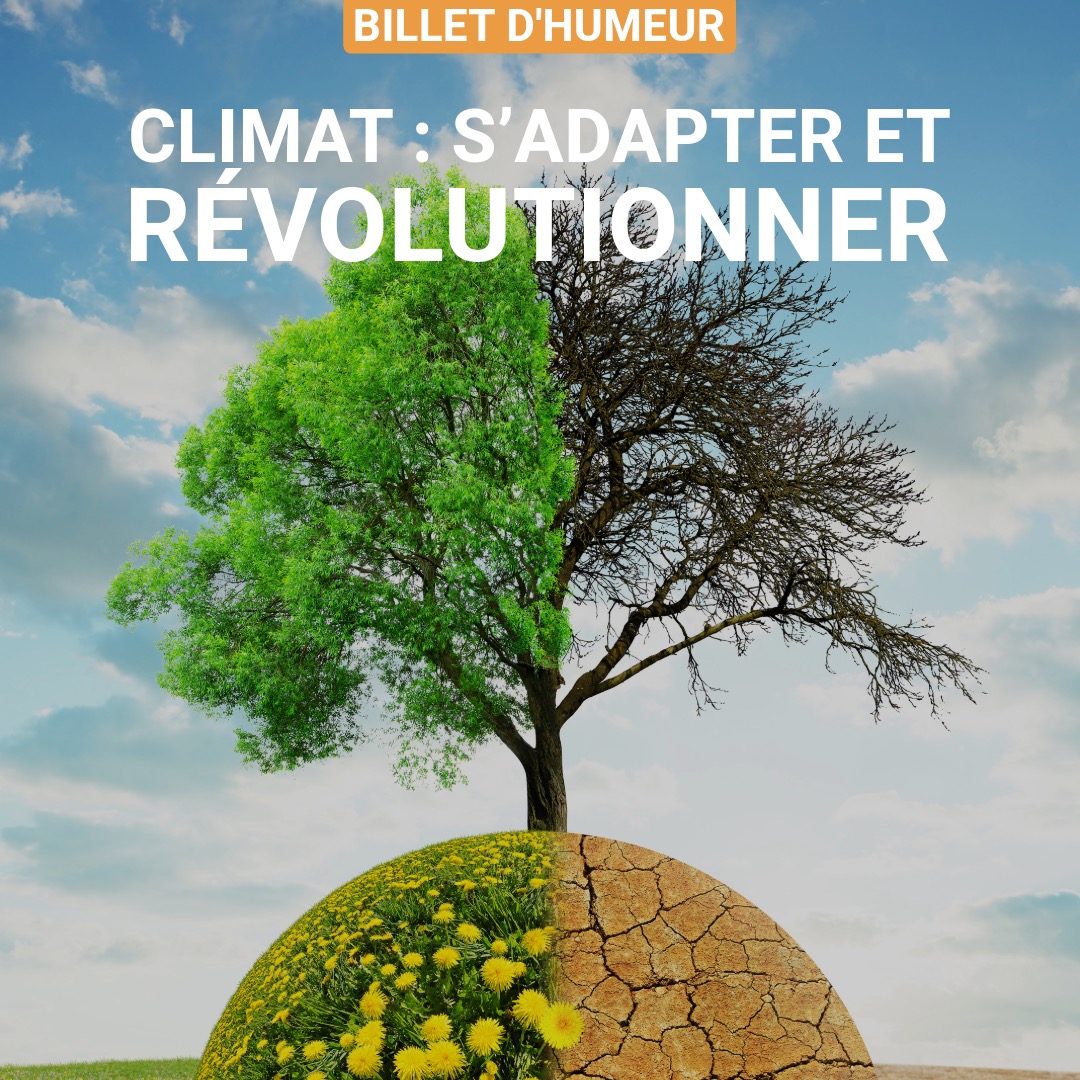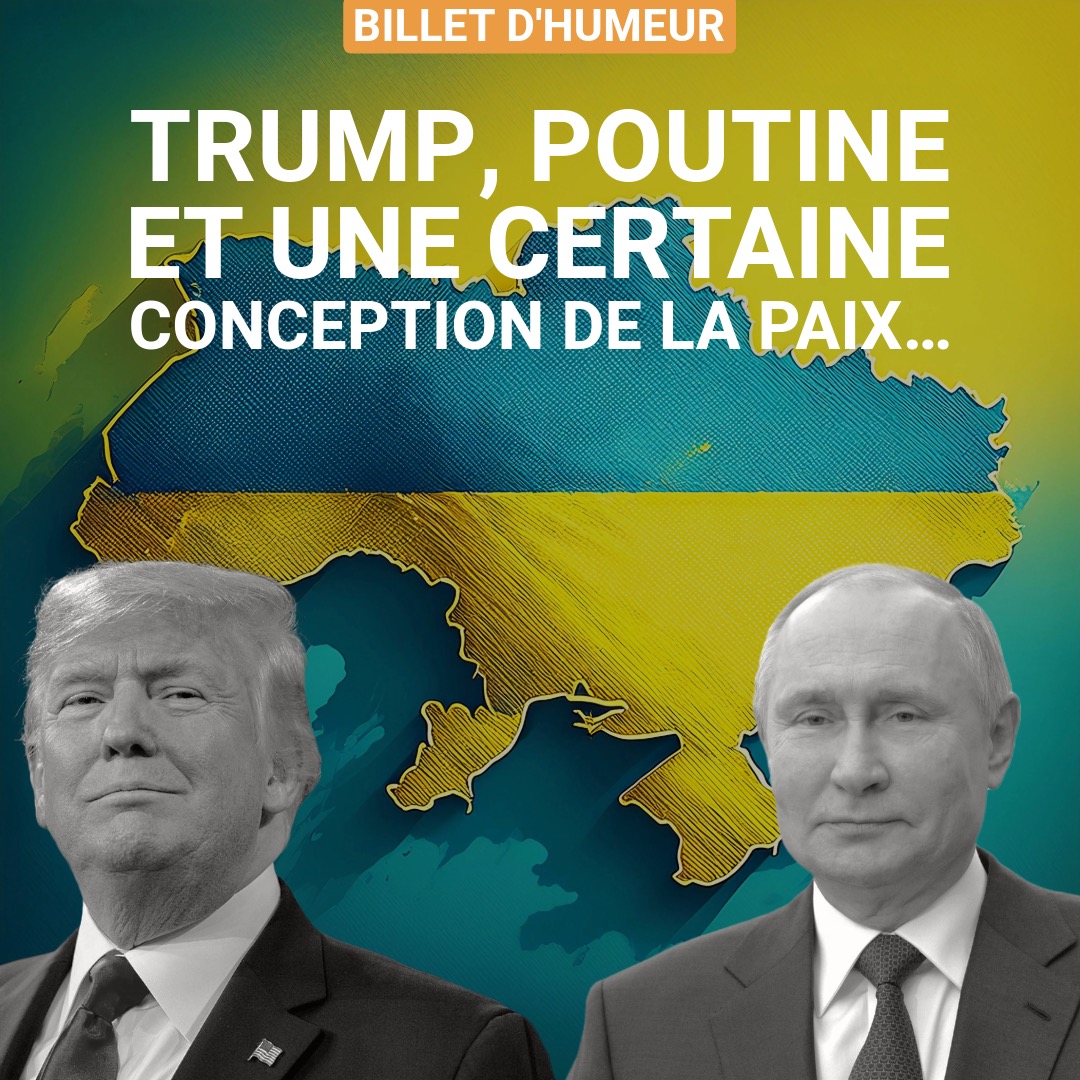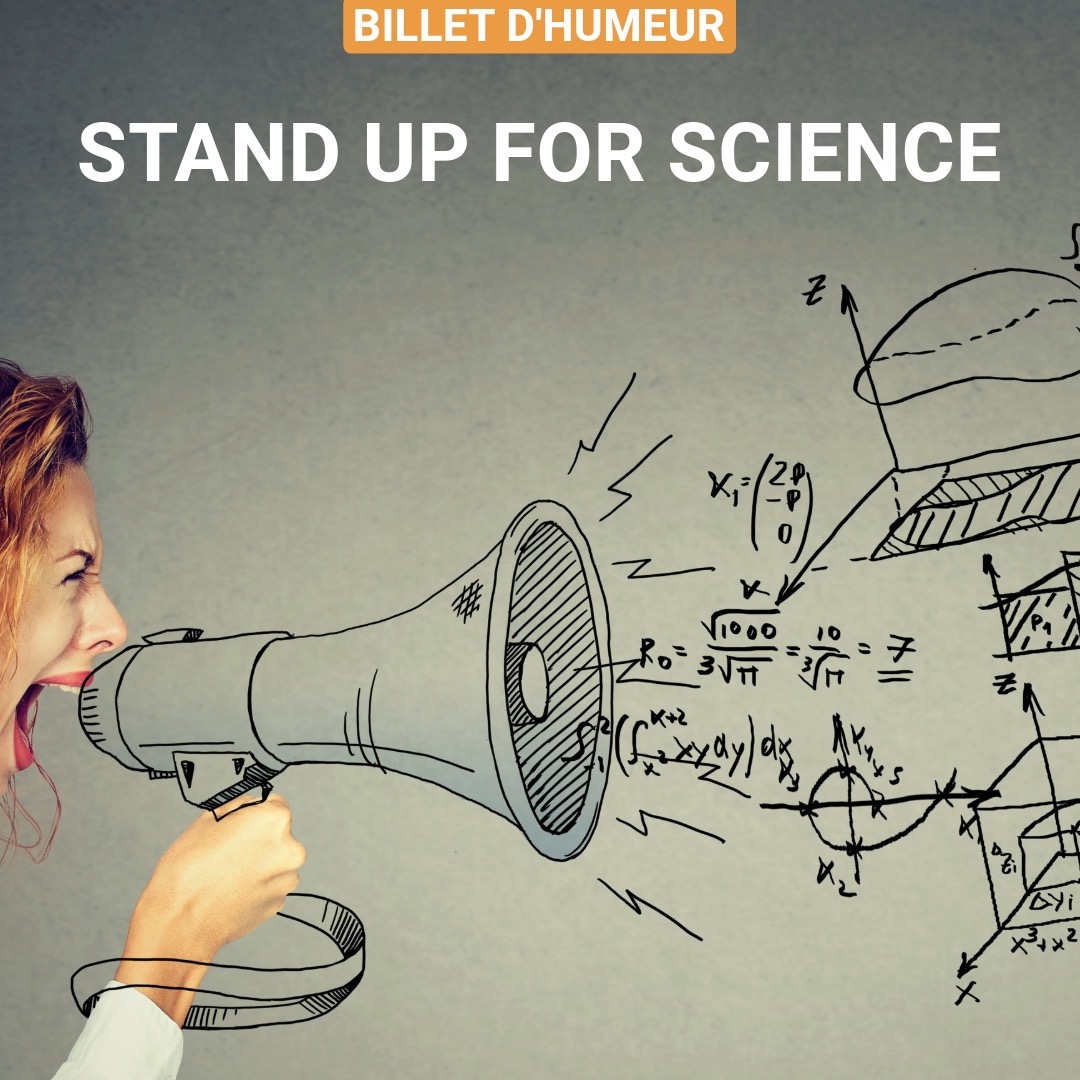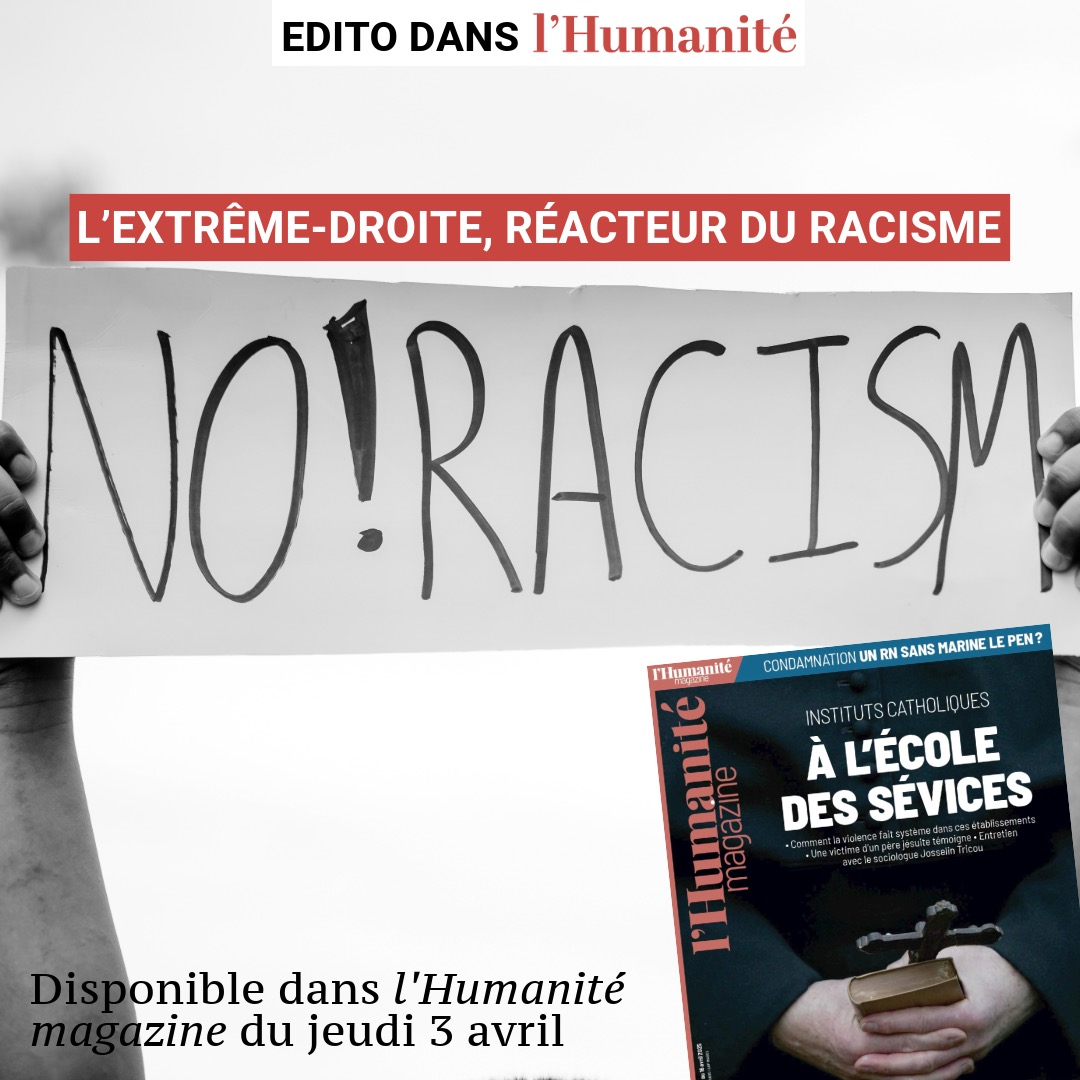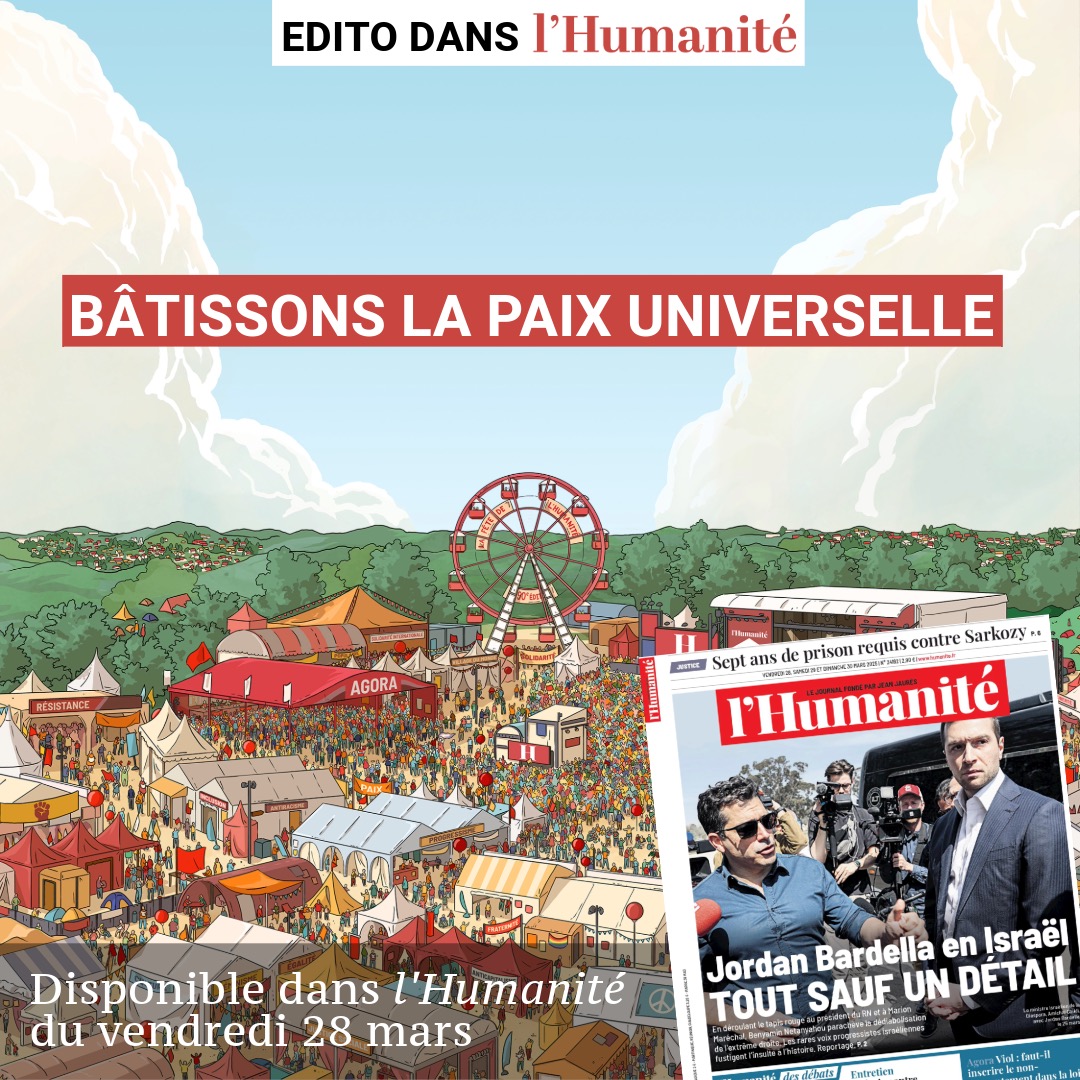Il y a cinq ans, le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait que le COVID-19 était une pandémie mondiale. La plus grande crise sanitaire depuis la pandémie de grippe de 1918-1920.
5 ans déjà. Une éternité. Un autre monde. Un souvenir lointain, et, en même temps, tellement présent, ancré dans nos vies.
Le 16 mars 2020, suite à l’annonce du Président Macron, la France basculait dans une nouvelle dimension et se confinait.
L’arrêt immédiat de nos activités, de nos déplacements, de nos interactions sociales.
Une pause inédite et internationale dans ce monde où d’habitude tout va vite et rien ne s’arrête jamais. Une téléportation directe vers un monde dystopique mais pourtant réel, celui d’une pandémie à laquelle, malgré des alertes, personne n’était préparée.
Une pause vertigineuse nous entrainant en quelques jours dans l’inconnu et l’angoisse avec le décompte des premiers décès.
Chacun se souviendra longtemps de cette période particulière. Pour certains, elle a constitué une parenthèse presque enchantée, celle d’un nouveau rythme, celle d’un autre rapport à un monde devenu, en apparence, différent, et celle de l’espoir d’inventer de nouveaux modes de vie, de remettre en cause de l’existant, notamment le capitalisme effréné.
Chacun se mit à espérer que cette pandémie, comme un signal d’alerte, servirait de déclencheur pour aller vers autre chose : davantage de solidarités, une volonté de transformer de la société et de préserver la nature.
Ce virus a réussi en quelques semaines à mettre l’économie mondiale à l’arrêt. La croissance a chuté dans de nombreux de pays. Parallèlement, les émissions de Co2 ont fortement diminué, du fait de l’arrêt des productions, du trafic aérien et routier.
La nature a repris ses droits, avec le chant des oiseaux au lieu du vacarme des klaxons dans les grandes villes, avec des canards se baladant sur le périphérique parisien..
Mais au-delà de ces aspects idylliques, cette pandémie a surtout révélé au grand jour, que notre système de santé était à bout. Les hôpitaux ont été submergés, les services d’urgence et de réanimation saturés. Et ce, malgré l’incroyable implication et dévouement des soignantes et des soignants, premiers de corvée, bien peu récompensés depuis.
Des années de restriction budgétaire ont conduit à la fermeture de milliers de lits, de services, d’établissements, ont supprimé des milliers de postes. Alors qu’hors période de crise, l’hôpital français est déjà sous-dimensionné, il lui était, de fait, impossible de faire face à une pandémie…
Cette crise a aussi révélé les pénuries.. de masques, de test de dépistage, de curare indispensable en réanimation. La France, alors sixième puissance mondiale se trouva fort dépourvue lorsque la bise fut venue…
Puis, ce fut l’heure du grand raté du laboratoire français Sanofi, qui, par des choix stratégiques a été incapable, contrairement à ces concurrents étrangers de sortir un vaccin..
Notre souveraineté industrielle et sanitaire, du fait de délocalisations et de désindustrialisation a été mise à mal. Alors que 80 % des principes actifs des médicaments sont produits en Chine et en Inde, dans un monde à l’arrêt, sans circulation des marchandises, notre dépendance était totale. Toutes les faiblesses de notre système industriel, résultat de décennies de choix politiques libérales, jaillirent devant nos yeux.
A ceci, se sont ajoutées, des décisions erratiques de la part des autorités, allant de l’inutilité du port du masque à son obligation, la création d’un état d’urgence sanitaire octroyant des pouvoirs démesurés au premier ministre, permettant de réduire à néant les libertés individuelles, introduisant une conception très sécuritaire et infantilisante de la gestion de la crise, l’installation d’un système de surveillance généralisée de la société : couvre-feu, attestation de déplacement, contrôles policiers, distance sociale… Certaines règles, censées être temporaires sont toujours en vigueur, ce qui ne peut qu’être inquiétant en cas d’arrivée du RN au pouvoir.
Cette conception de la crise, malgré une certaine discipline du peuple, a ainsi amplifié la défiance vis-à-vis du pouvoir : au lieu d’un peuple entier faisant confiance à ses décideurs et convaincu par exemple de l’utilité du vaccin, nous avons dû faire face au sentiment d’un complot mondial de la part de certains citoyens.
Sans aller jusqu’aux thèses farfelues et dangereuses des ‘’anti-vax’’ comment ne pas se questionner sur cette mesure de santé publique lorsqu’elle s’avère être un véritable jackpot pour les Big Pharma ? Faute d’avoir extrait les médicaments de la sphère marchande, d’avoir mis un place un pôle public du médicament de la production à la distribution, d’avoir utilisé la levée des brevets, l’opacité a alimenté la défiance et a créé des divisions entre les pro et anti-vaccins.
Chacun se souvient également des propos de l’ancien président brésilien Bolsonaro s’opposant totalement aux vaccins, laissant mourir des centaines de milliers de Brésiliens.
De même, comment oublier l’accaparement par les pays riches dans ce système capitaliste, des doses de vaccin, au détriment du reste du monde ?
En France, cette crise sanitaire restera également synonyme du fameux ‘’quoi qu’il en coute » qui s’est surtout traduit par la prolifération des aides publiques versées aux grandes entreprises, sans aucune contrepartie.. Des milliards versés, sans contrôle, soi-disant pour soutenir l’emploi.. 5 ans plus tard, la plupart des entreprises bénéficiaires ont taillé dans leurs effectifs et l’argent s’est envolé !
La crise aura vu aussi exploser les violences conjugales et intrafamiliales, se développer les inégalités scolaires, aura mis en lumière les inégalités socio-spatiales et a engendré des conséquences durables sur la santé mentale des enfants et des adolescents.
La pandémie passée, les bilans ont été faits, les responsabilités ont été établies : la bureaucratie d’Etat n’a pas anticipé et a été incapable d’être réactive.
Le bilan humain de cette pandémie est terrible, certains souffrent encore aujourd’hui de Covid long.
La question qui reste en suspens et dont chacun redoute la réponse : a-t-on tiré les leçons de cette pandémie et sommes-nous prêts à en affronter une nouvelle, dans de meilleures conditions ? A-t-on modifié notre rapport à la nature, comprenant enfin que l’activité humaine avait des répercussions sur l’environnement, sur notre santé et notre bien-être ? Avons-nous compris que nous faisons partie du vivant et que notre santé dépend de la santé des écosystèmes ?
Enfin, à l’heure où la science, les progrès scientifiques sont attaqués notamment par la première puissance mondiale et les climatosceptiques, il y a de quoi être inquiets..
Alors que chacun aspirait à un autre modèle de développement, la guerre, déjà bien présente dans le vocabulaire présidentiel pour s’attaquer à ce virus, est entrée désormais dans une autre réalité et n’est plus que sanitaire..