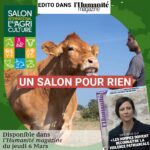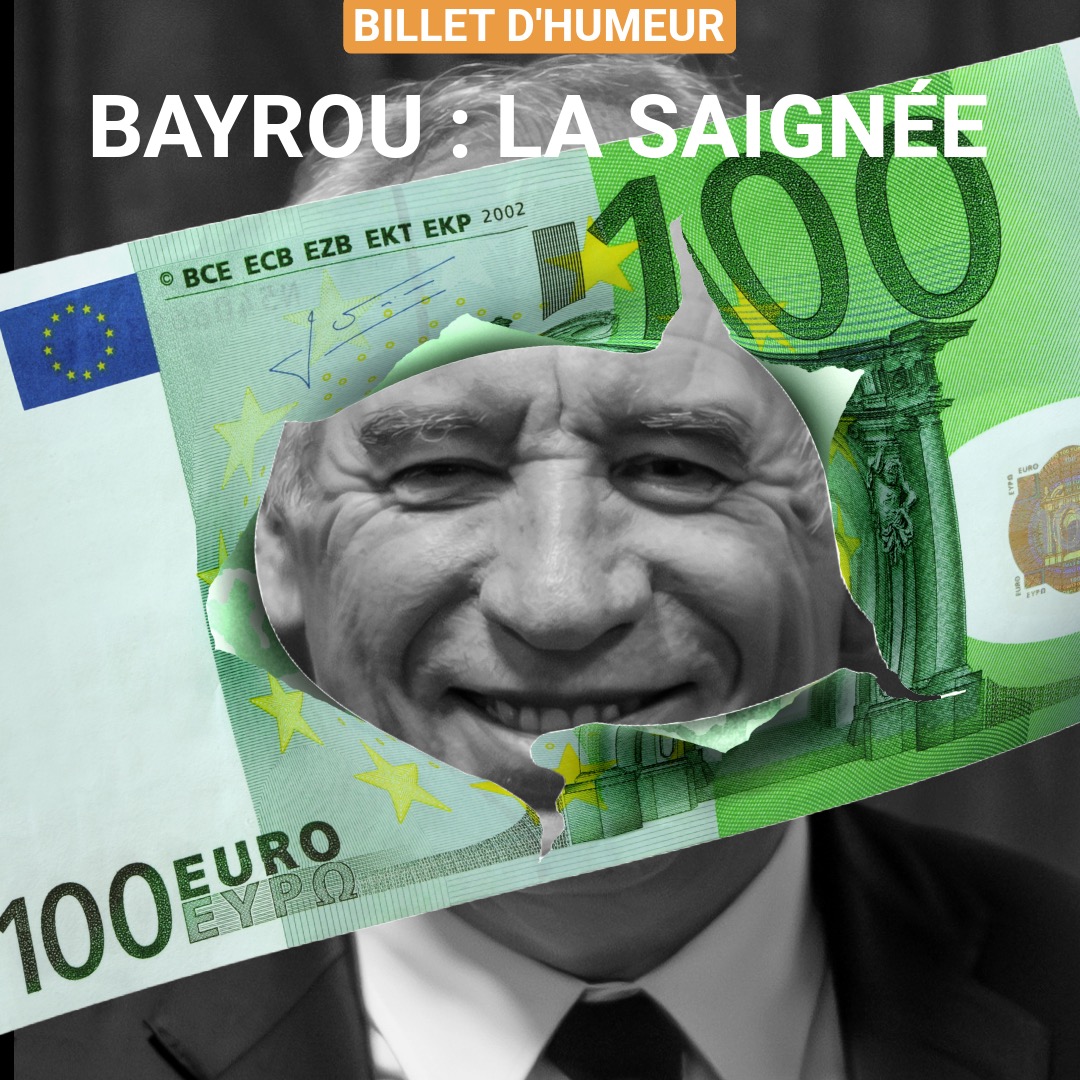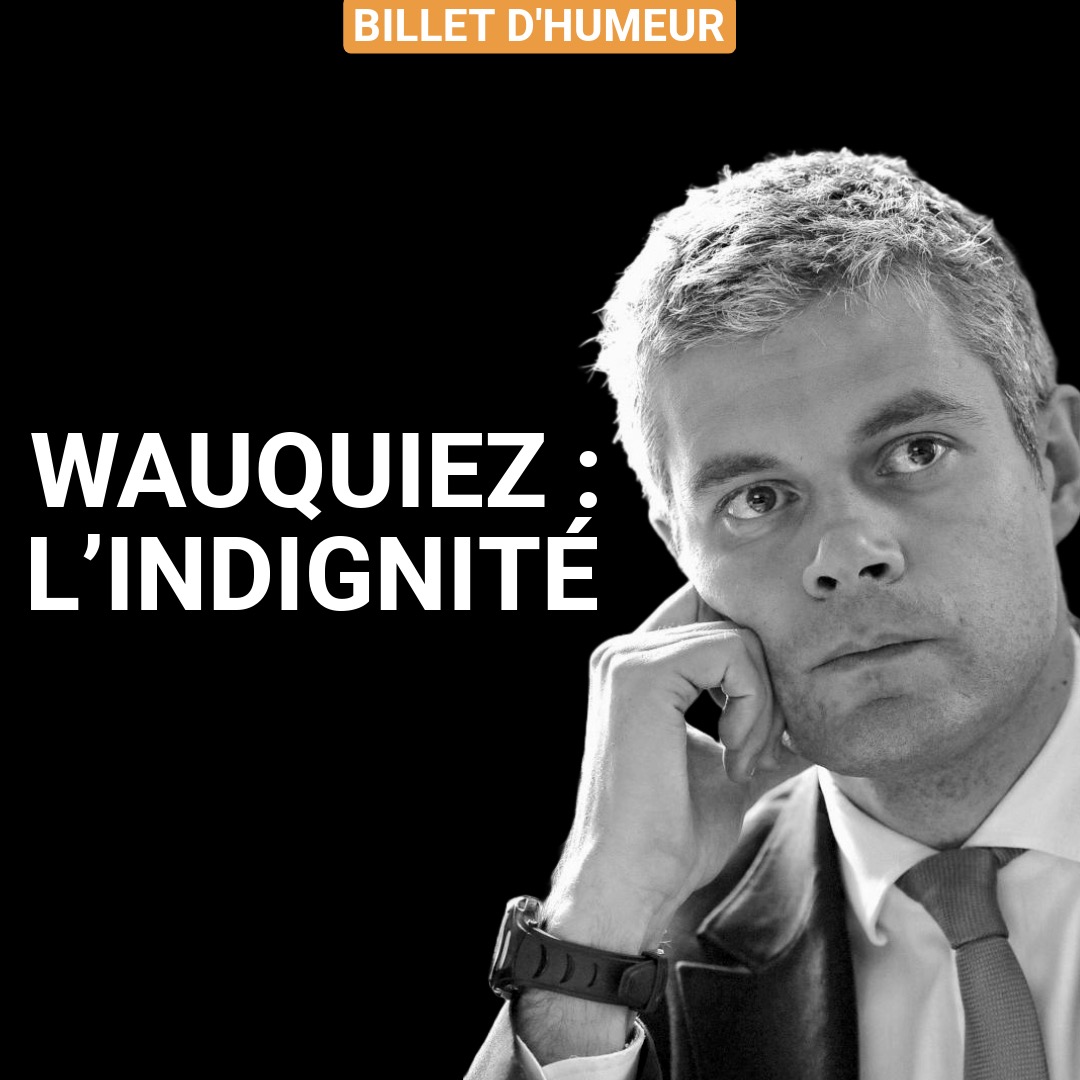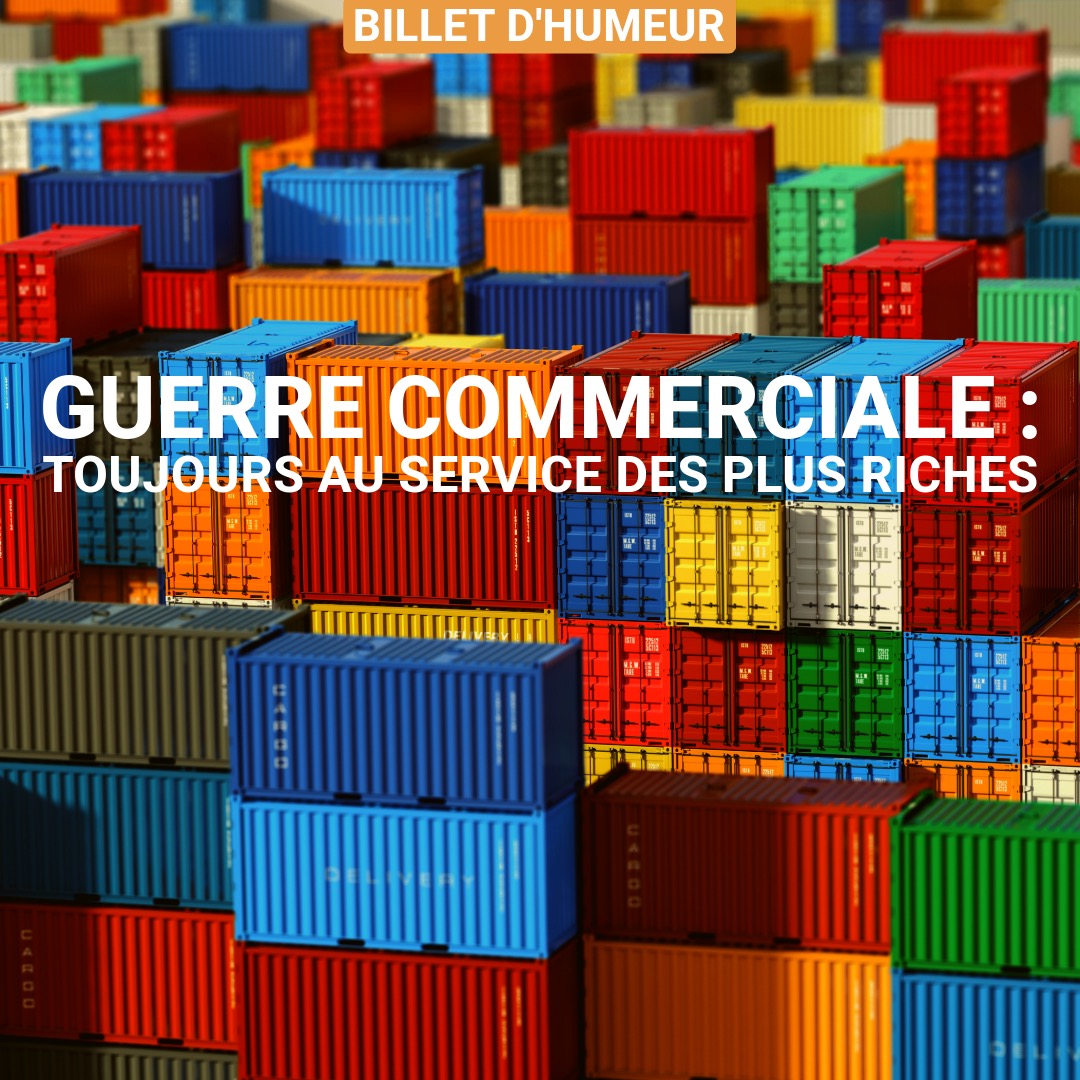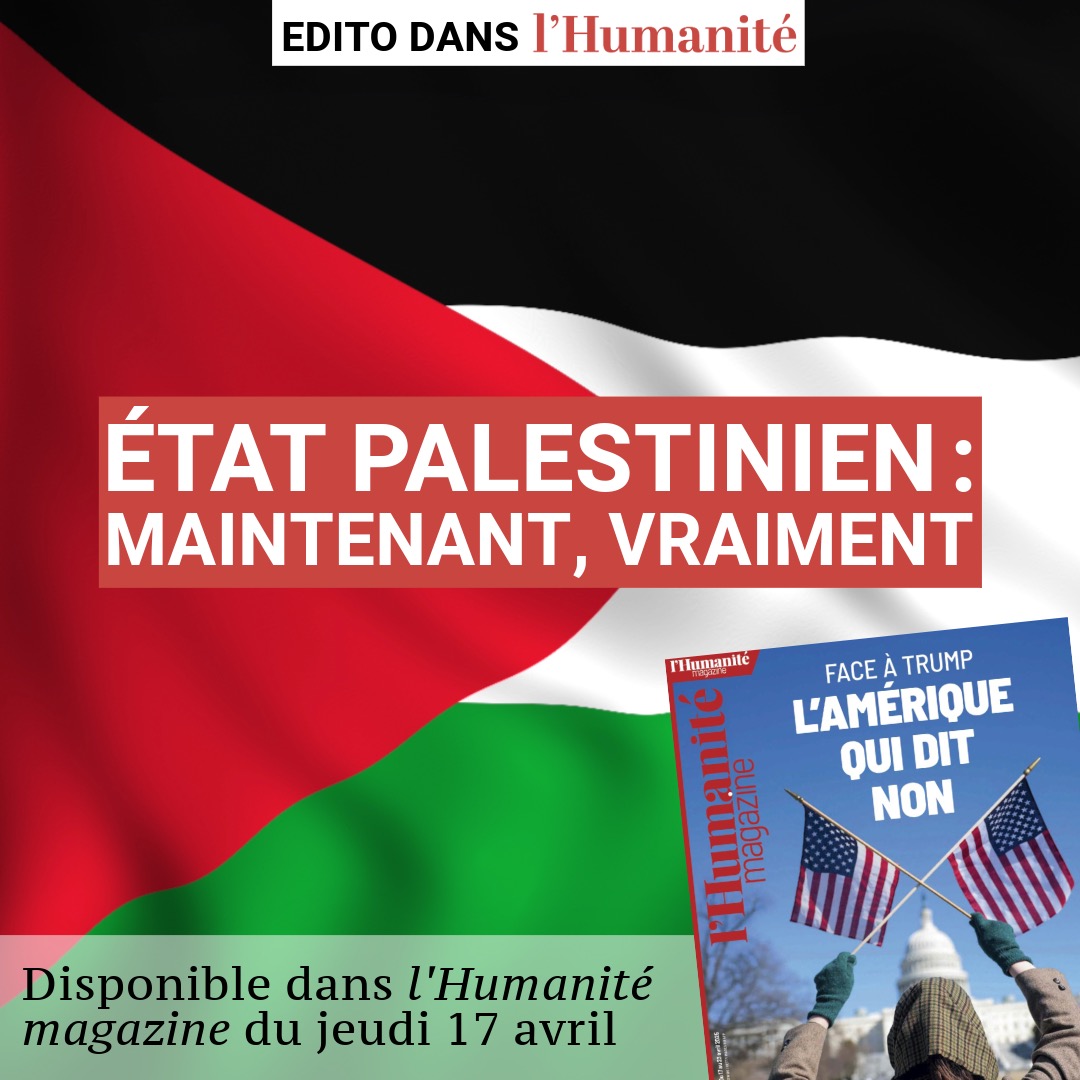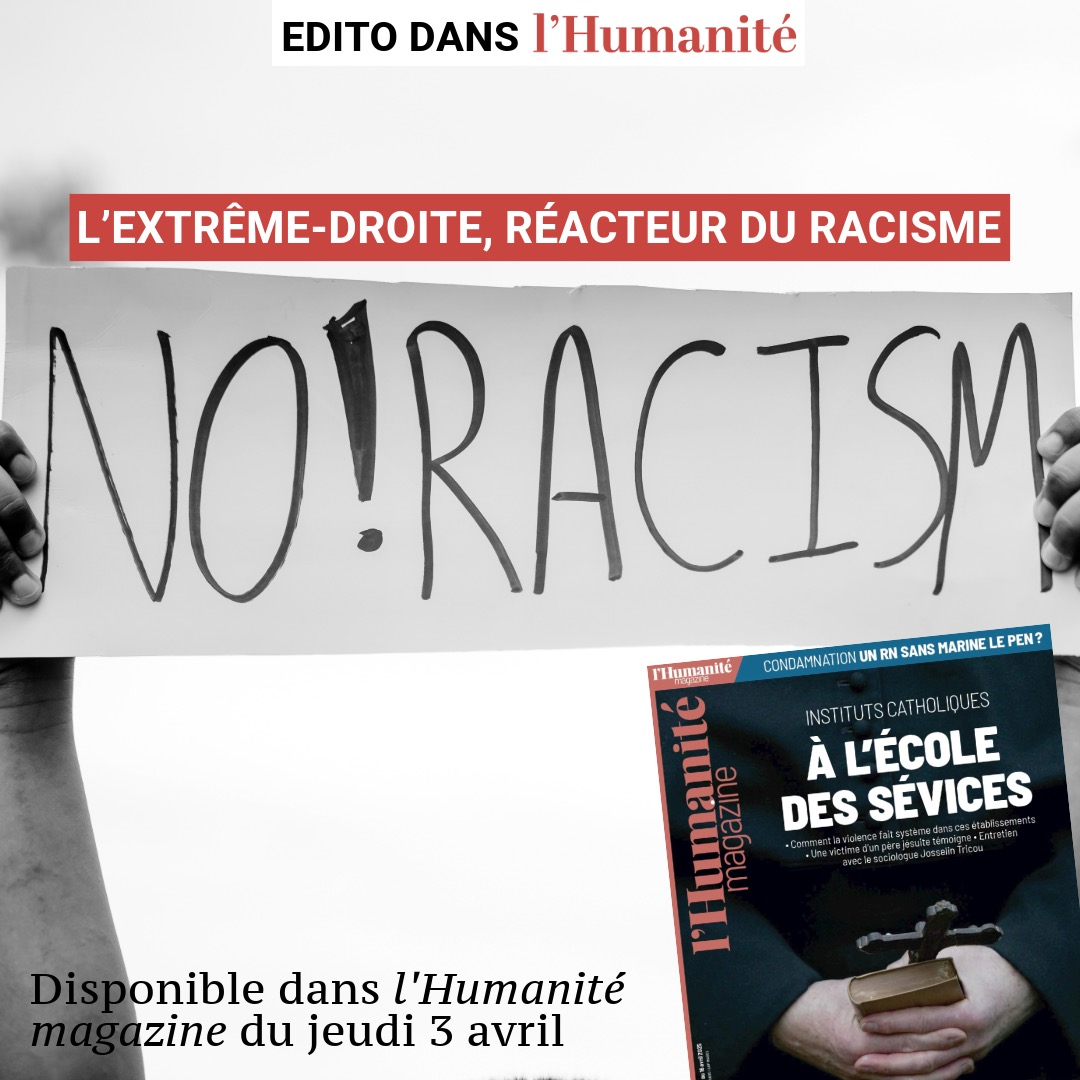Amélioration de la lutte contre le trafic de stups
Cette semaine, nous avons examiné une proposition de loi transpartisane visant à renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants ; ce travail part d’un constat partagé sur la nécessité de faire reculer le pouvoir de ces réseaux internationaux dans notre pays, qui prospèrent sur le désengagement de l’Etat et la précarisation de la population.
En Seine-Saint-Denis notamment, des maires s’inquiètent de la montée en puissance des trafics, et appellent à un renforcement des moyens dédiés par le ministère de l’Intérieur aux commissariats de plein exercice.
La mesure phare de ce texte est la création d’un parquet national spécialisé, nommé PNACO, qui enquêtera sur les faits les plus graves et complexes en lien avec le trafic de stupéfiants.
Sont également à noter la création d’une procédure « d’injonction pour richesse inexpliquée » qui permet de contraindre les suspects à s’expliquer sur leur train de vie lorsque l’origine des fonds est douteuse, ou l’élargissement des mécanismes de gel judiciaire et administratif des avoirs pour sanctionner financièrement les trafiquants ou la reprise du statut de repentis.
Cependant, nous avons alerté en hémicycle sur le nécessaire renforcement des moyens humains dédiés à cette mission.
Alors que les effectifs des douanes et des Parquets sont extrêmement insuffisants et que les gouvernements successifs ont œuvré à affaiblir la police judiciaire au profit d’un renforcement de la police administrative, il serait illusoire de penser que la lutte contre le trafic de stupéfiants peut progresser si les services publics ne sont pas mis en mesure de remplir cette nouvelle mission.
De plus, certains amendements déposés et votés par la droite, dans la continuité des demandes des syndicats de police, sont sources d’inquiétudes et atteignent l’équilibre fragile du texte. Je pense notamment à la restriction des droits de la défense par la création du « dossier coffre-fort », qui permet de garder secrètes les techniques d’enquête et ne rend accessible aux avocats que le résultat des investigations. De même, il est à craindre l’injonction pour les plateformes comme Telegram, Signal ou Whatsapp de fournir leurs clefs de chiffrement, une technique très intrusive, qui constituerait un dangereux précédent.
Car nous n’ignorons pas que la lutte contre les stupéfiants, comme le terrorisme, permet d’avaliser de manière dérogatoire des pratiques liberticides, qui finissent toujours par s’étendre au-delà des cadres dans lesquels elles ont été créées.
Cette démarche transpartisane ne doit pas masquer les profondes fractures qui existent dans notre conception de la lutte contre le trafic de stupéfiants.
A gauche, il nous faut absolument nous départir du cadrage médiatique imposé par le duo de choc Retailleau-Darmanin autour de cette loi. De la « mexicanisation de la société » au « Narco-trafic », « narco-racailles », « narco-complices » ou « narchomicides », ce texte devient un étendard de leur communication et leur idéologie autoritaro-sécuritaire, et ouvre la porte à une surenchère liberticide.
J’en tiens pour preuve la stratégie de communication de Darmanin, qui annonce la création d’un centre pénitentiaire dédié aux condamnés liés au trafic de drogue, une mesure qui n’est pas contenue dans ce projet de loi, mais qui lui permet de développer sa prose réactionnaire sur les plateaux télés.
A l’escalade sécuritaire pour chercher à draguer l’électorat du RN, nous préférons nous inscrire dans une démarche fondée sur les travaux de scientifiques, des associations de terrain et des élu.e.s locaux.ales qui préconisent, en lieu et place d’une criminalisation stérile, de renforcer la prévention pour les usagers de drogue, et d’améliorer les moyens donnés à la justice pour lutter contre ces trafics, qui pénalisent le bien-être des habitantes et habitants, notamment en Seine-Saint-Denis.
L’agro-business l’a souhaité, la droite l’a fait !
Cette semaine, le Sénat a examiné une proposition de loi déposée par le groupe LR qui viserait à « lever les freins pour les agriculteurs ». Ce condensé de mesures rétrogrades et climaticides tente de remettre au goût du jour la vieille marotte qui oppose protection de l’environnement et monde agricole.
Remise en cause des dispositions de participation citoyenne nécessaires à la mise en place de projets de retenue d’eau ou d’extension des bâtiments d’élevage, dans un contexte où les mobilisations écologistes fleurissent partout dans le pays et rencontrent une criminalisation inédite de la part des autorités.
Remise en cause de la loi Egalim qui interdit le cumul de la fonction de conseil et de commercialisation des produits phytosanitaires, pourtant fondé sur la règle intangible que nul ne peut être juge et partie.
Remise en cause de l’interdiction de certains pesticides, alors que leurs effets nocifs pour la santé sont désormais actés, et font comme premières victimes … les agriculteurs et agricultrices !
Comme je le rappelais dans l’hémicycle, les seules propositions formulées depuis des années par la droite consistent à revenir sur les timides avancées en faveur de l’environnement, et nous privent d’une réflexion nécessaire sur les alternatives pour un modèle agricole plus vertueux.
Car l’industrie chimique et agro-alimentaire n’a qu’un seul objectif : maintenir ses profits, quel qu’en soit le coût pour le vivant.
Et les exemples ne manquent pas : amiante, chlorodécone … combien de temps a-t-il fallu pour interdire officiellement ces produits alors que leurs effets nocifs étaient connus de toutes et tous, et que les victimes se comptent encore par dizaines de milliers ?
Un bien mauvais signal alors que se tiennent les élections professionnelles agricoles, et que nous étudierons la semaine prochaine la nouvelle loi d’orientation agricole.