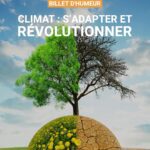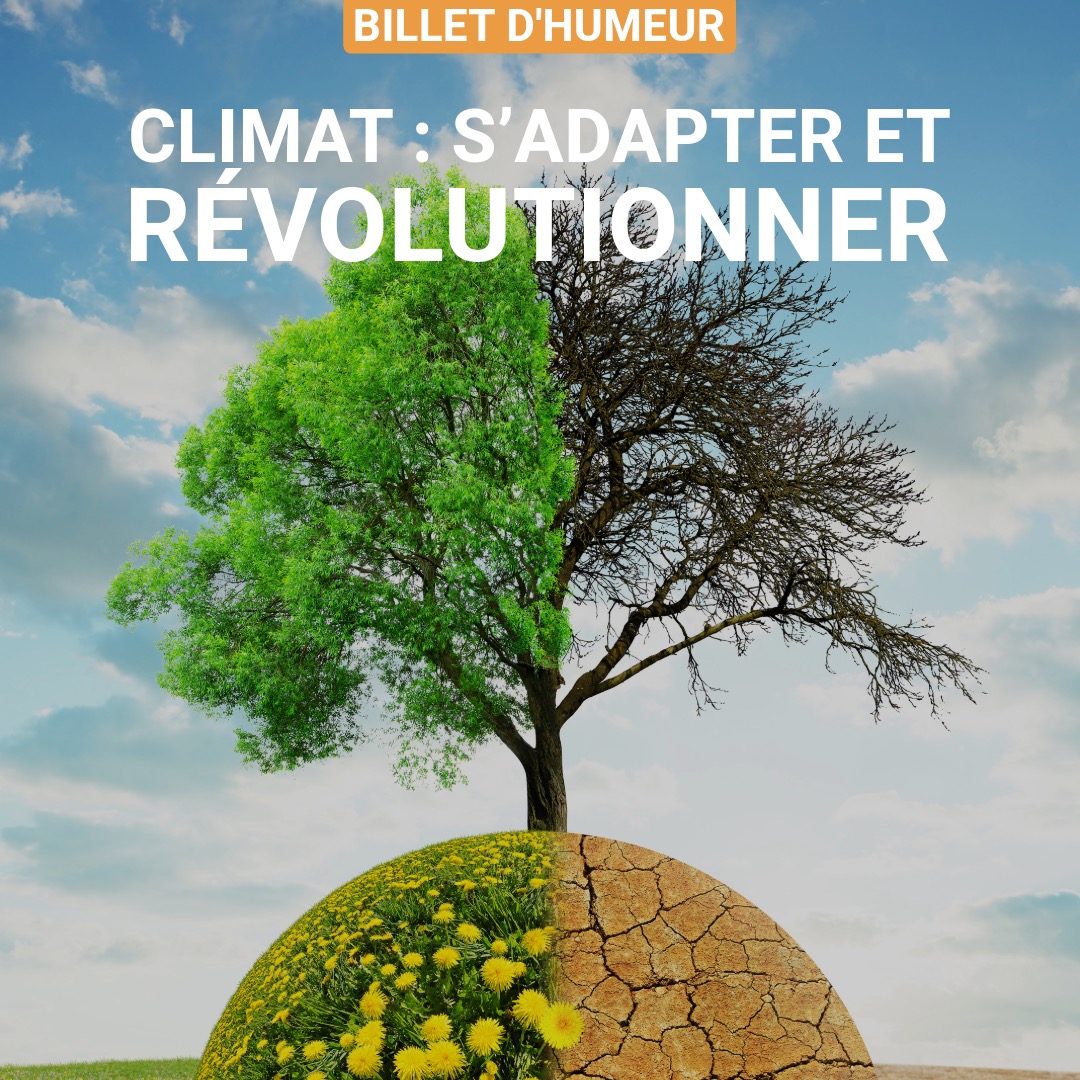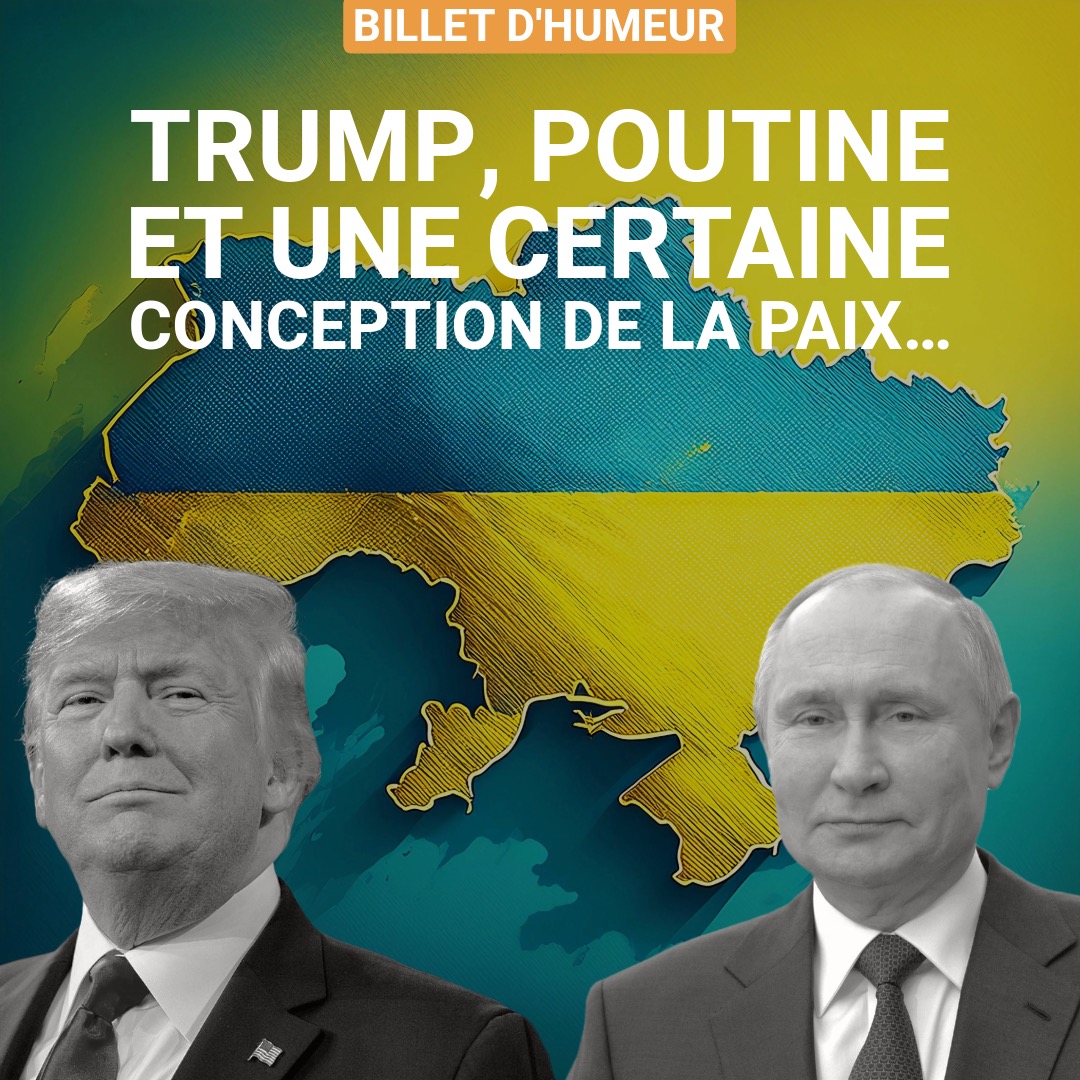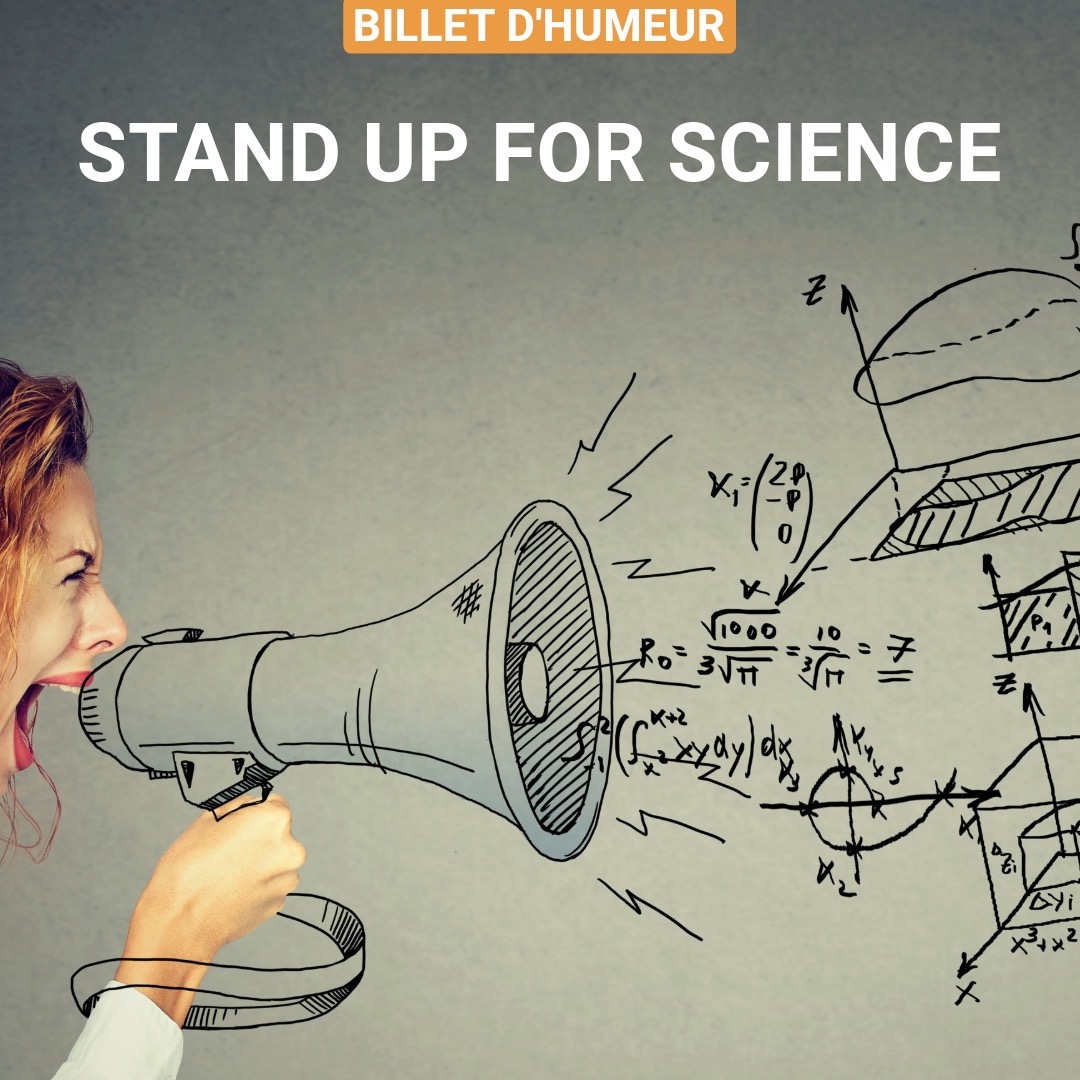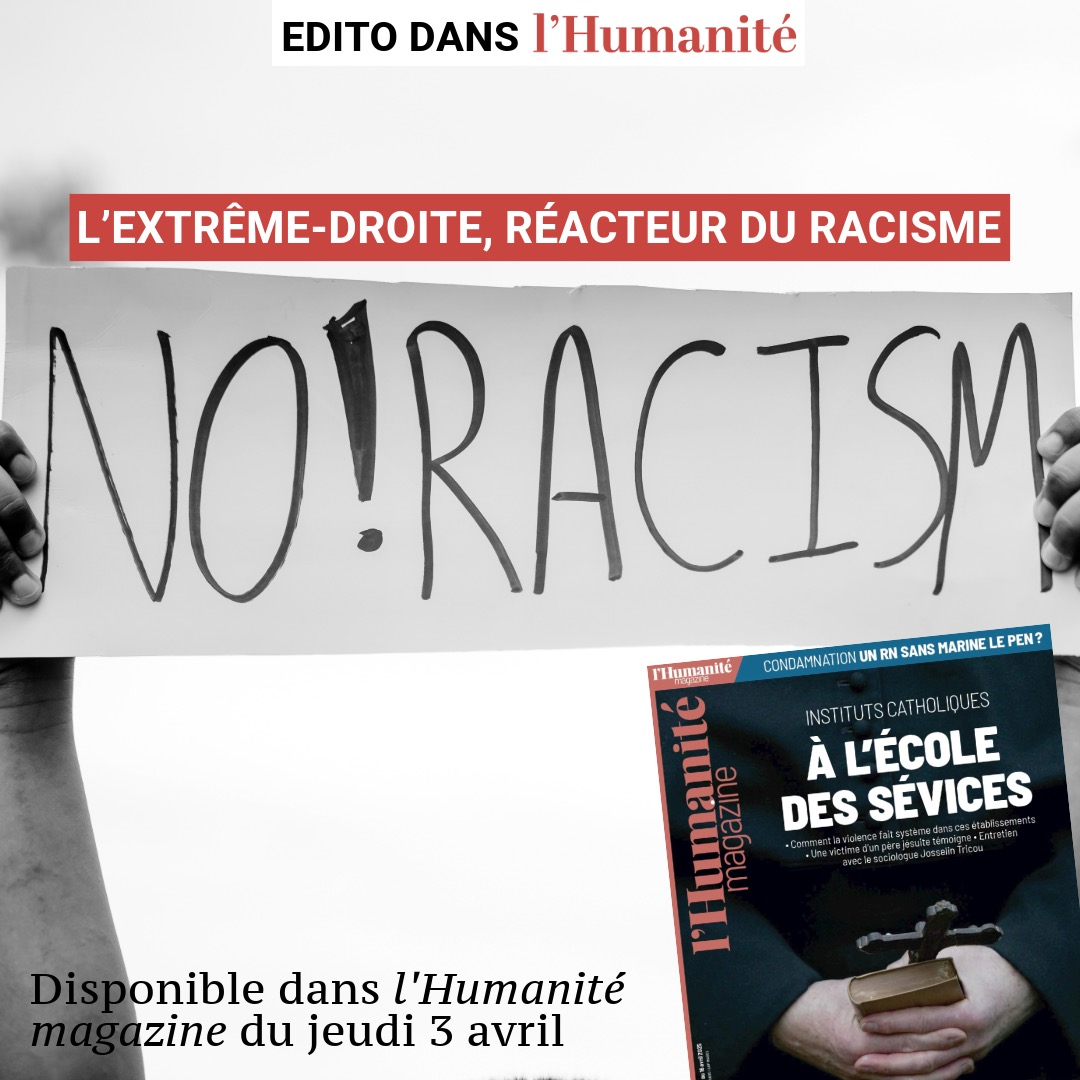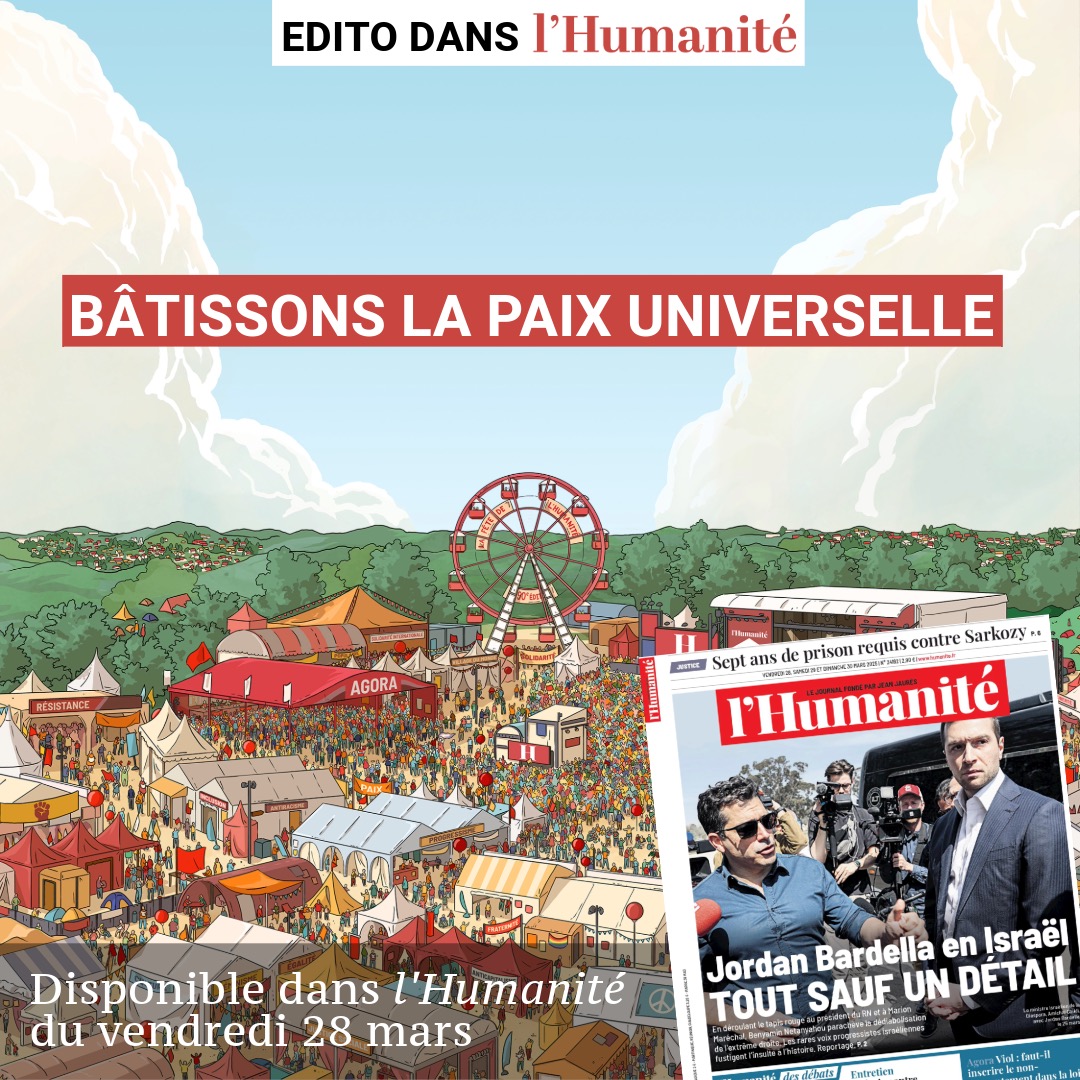C’est une nouvelle étape dans la lutte pour la justice environnementale dans les outre-mers. La cour d’appel de Paris a reconnu une nouvelle fois le préjudice subi par les populations antillaises, victimes de la pollution au chlordécone. Les plaignants ont remporté une nouvelle victoire judiciaire, confirmant ainsi la condamnation en première instance de l’Etat en 2022.
« Fautes caractérisées » : voici l’expression la plus marquante du rendu des magistrats. Il était de notoriété publique que le chlordécone, pesticide utilisé massivement dans les épandages des champs de bananes, était dangereux pour la santé et l’environnement.
Le produit a été interdit définitivement en France en 1993, en retard par rapport à nos voisins. Malgré cela, il a fallu attendre 2003 pour qu’un premier plan de lutte et de saisie des stocks aux Antilles soit effectif. Dix années de trop, dix années de mépris surtout quand l’on sait que ce pesticide était davantage utilisé aux Antilles dans les plantations de ces départements ultra marins.
La victoire judiciaire n’est toutefois pas totale. Le risque de pourvoi en cassation est possible de la part de l’Etat et des compagnies même si cela relèverait de l’indécence. De plus, seulement neuf travailleurs des plantations seront indemnisés pour des sommes certes symboliques mais dérisoires.
Au-delà d’une question pécuniaire, le préjudice dépasse largement ces seuls ouvriers agricoles. Santé publique France établit que 90% de la population adulte de Martinique et de Guadeloupe est contaminée. L’Etat a déjà mis en place un fonds national d’indemnisation des victimes du pesticide : une gageure puisque 66 personnes ont été indemnisées sur potentiellement plus de 12 000 travailleurs des plantations…
Les femmes ne sont pas reconnues comme victimes malgré des études sur les impacts sanitaires du pesticide en termes de grossesse, d’enfants handicapés…
Le préjudice est de toute manière plus global.
Les sols sont durablement pollués. Il y a un enjeu ici de justice environnementale pour non seulement indemniser mais réparer ce qui peut l’être car la pollution n’a pas disparu.
C’est derrière toute la biodiversité qui est touchée.
Dans ce scandale sanitaire, il faut bien comprendre les risques pour l’environnement, la nature, l’alimentation ne valent rien dès qu’il s’agit de nos concitoyens ultra-marins.
En réalité et une nouvelle fois, c’est le lien entre la métropole et ses anciennes colonies qui est à interroger. La départementalisation, grande avancée démocratique et sociale, n’a pas réglé les inégalités et les injustices de l’histoire de l’esclavage.
Le logiciel colonial reste prégnant dans le rapport à la propriété de la terre, à la marginalité de ces territoires.
Perçus comme des territoires d’extraction, d’un modèle agricole de monoculture orienté vers l’exportation, les départements d’outre-mer n’ont pas eu droit aux mêmes normes protectrices. Cela a contribué à alimenter la défiance, le ressenti vis-à-vis de Paris, comme nous l’avons vu avec le refus de vaccination ou d’autres sujets d’ordre sanitaire.
Les dernières mobilisations contre la vie chère, contre « la colonie de consommation » témoignent également d’une mauvaise gestion aux relents colonialistes. Les réponses ont été bien souvent d’ordre sécuritaires.
Il faut reconstruire ce lien de confiance en reconnaissant les préjudices environnementaux, moraux, sociaux, sanitaires de l’usage de ce pesticide. Un projet de loi au Sénat vise à reconnaître la responsabilité de l’Etat et c’est heureux. Il serait bon que l’Etat porte également cette mission de renouer le lien avec les acteurs locaux par une conférence réunissant tous les forces vives. Les entreprises de l’industrie chimique doivent aussi peyer leur part de responsabilité. Le capital ne peut sortir indemne de cette discrimination et de la mise en danger des populations antillaises.
Le combat pour la justice environnementale et sociale continue.