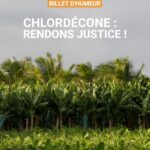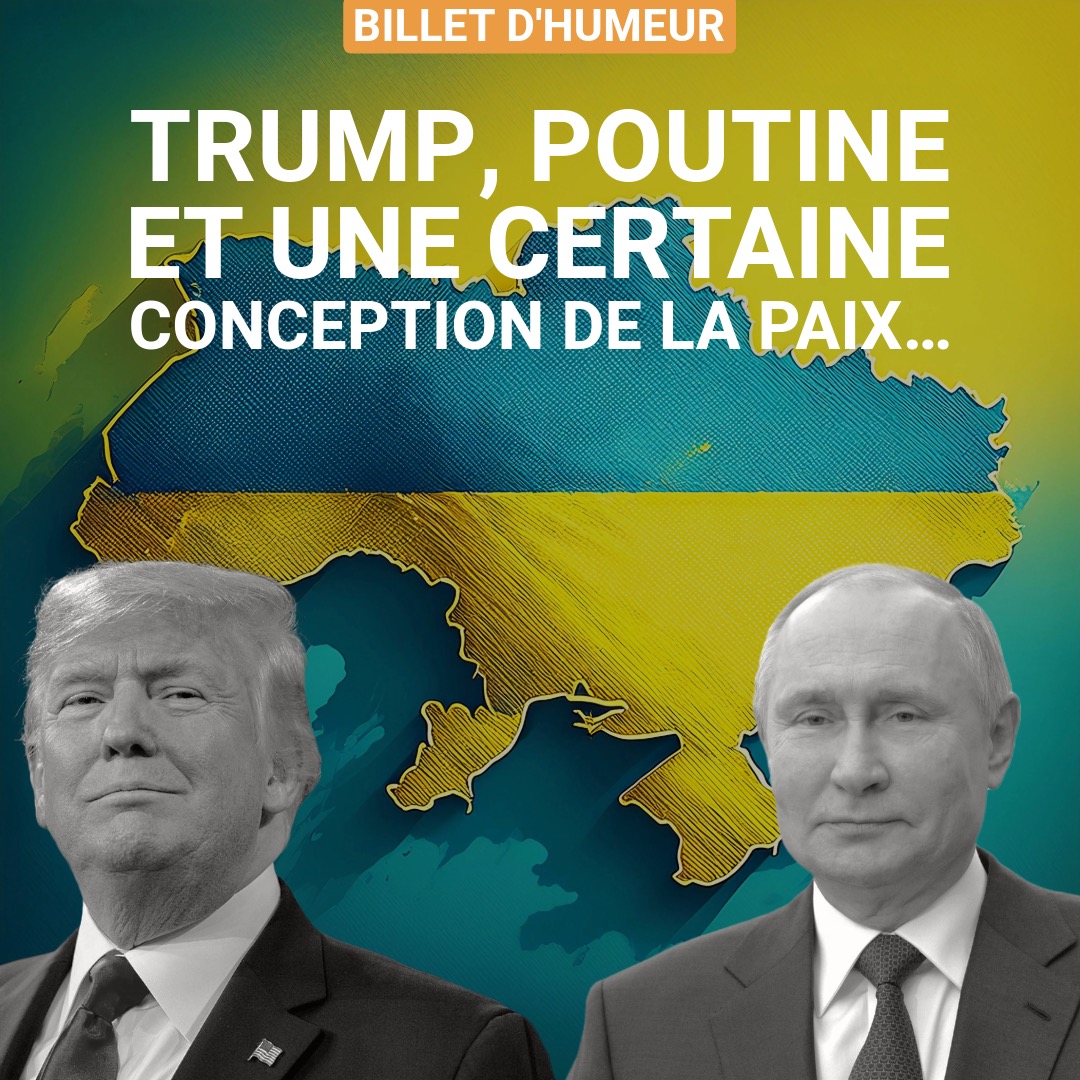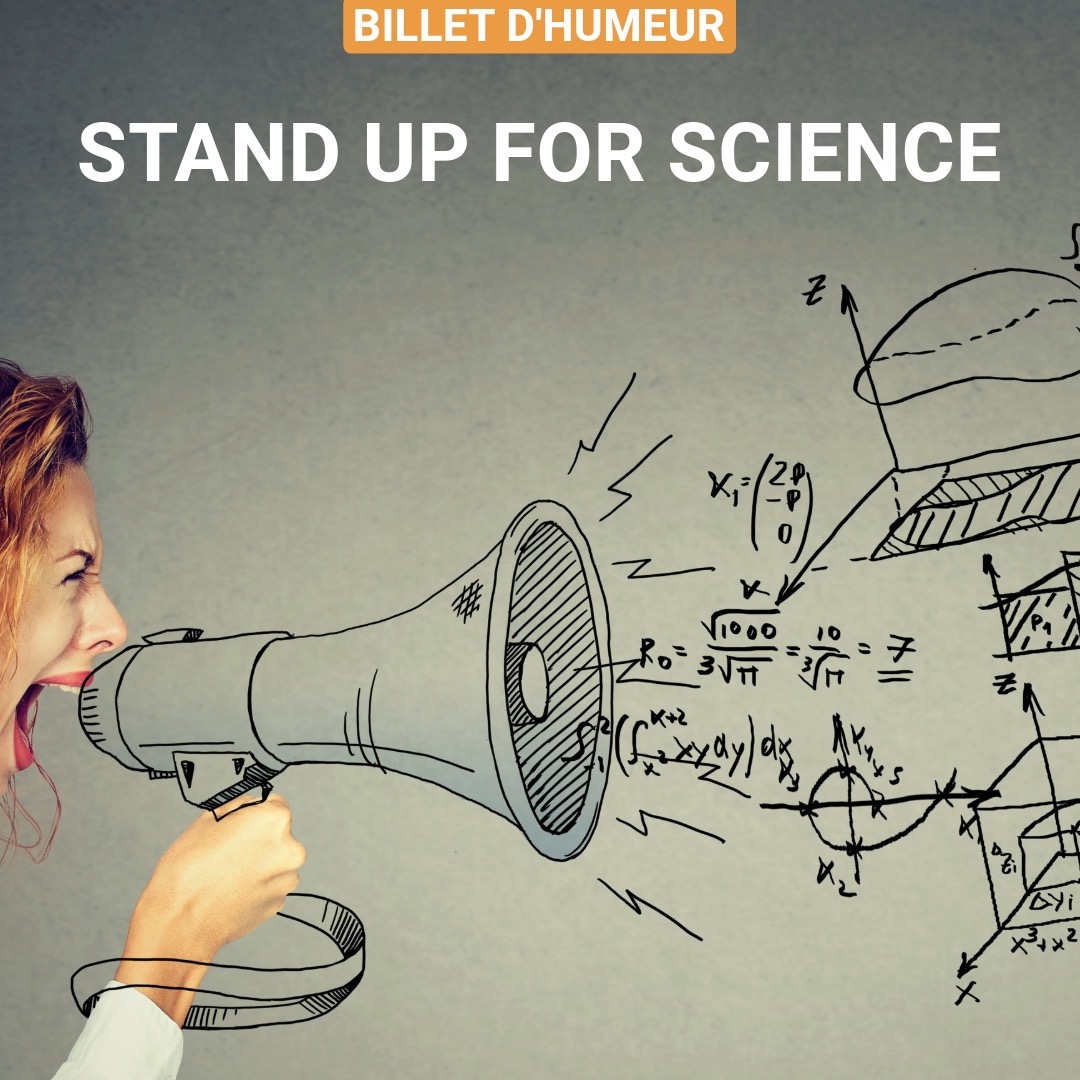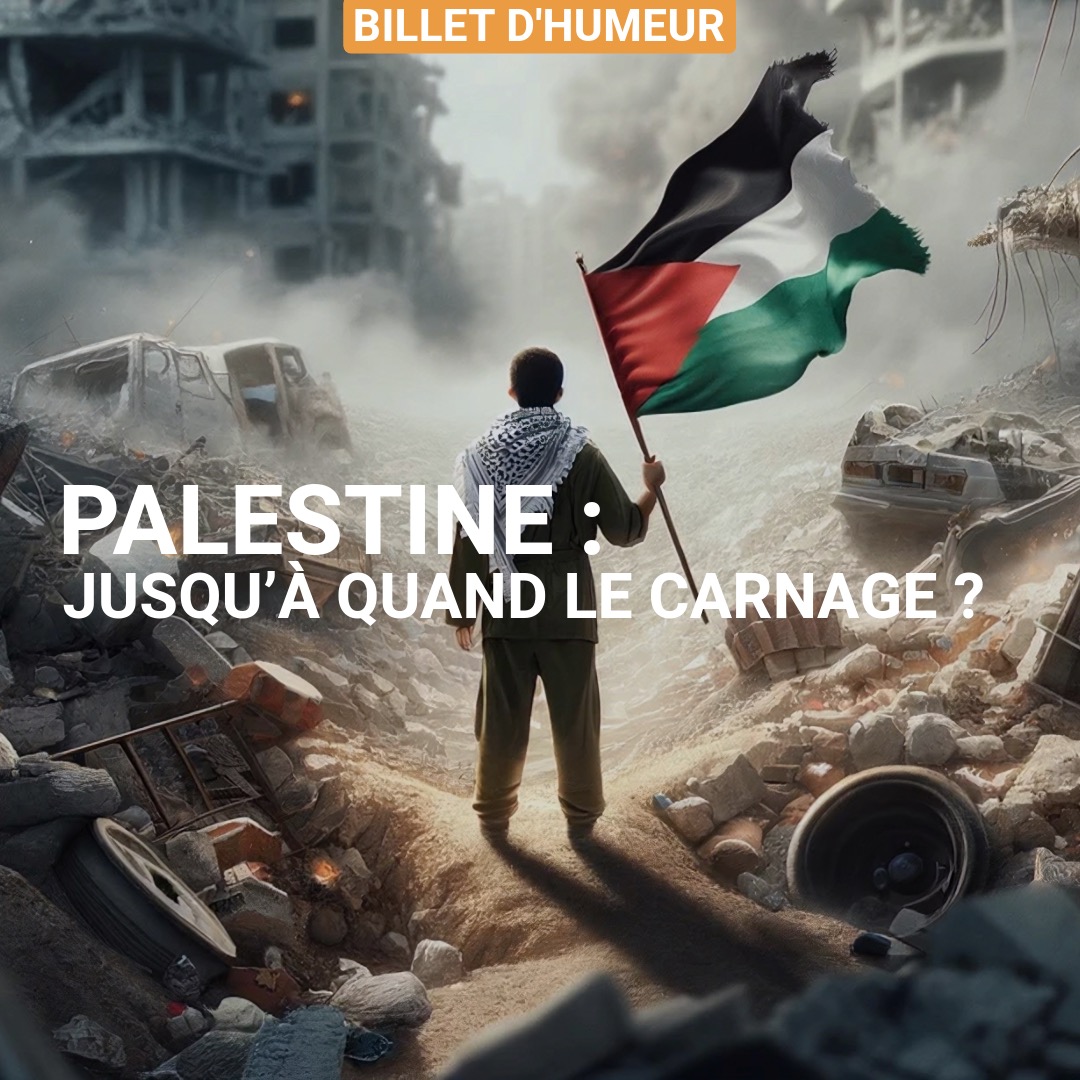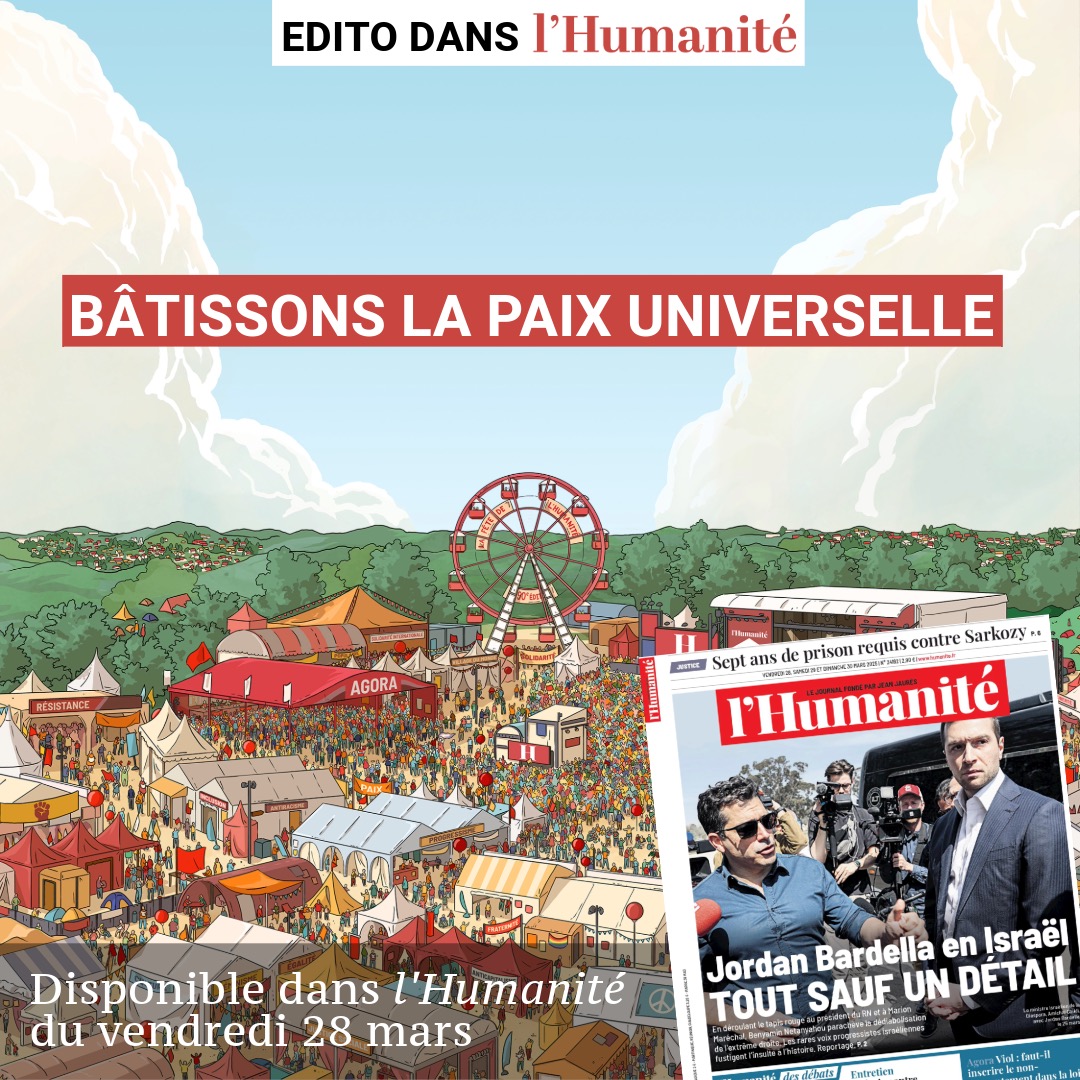Il y a quelques jours, le gouvernement a lancé un nouveau plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3). Il s’agit de déployer l’organisation de notre société au grand défi que constituent les évolutions de notre environnement. Alors que le premier quinquennat macronien a permis au président de s’afficher en défenseur de la planète, son gouvernement d’alors avait déjà annoncé un scénario très pessimiste sur l’évolution du climat. Finir ce siècle avec un réchauffement de + 4°C est en effet annoncé depuis plusieurs mois comme une perspective et c’est désormais ce modèle qui sert de référence.
Ce troisième plan d’adaptation sonne comme un rappel cruel des dangers que nous sous-estimons encore. Une France à +4°C en 2100, c’est clairement un bouleversement sans précédent de nos modes de vie. Ce chiffre est une moyenne et ne fait pas état des mutations rapides qui vont nous impacter fortement. Les évolutions sont alarmantes : avancée du trait de côte de plusieurs mètres, multiplication par 10 des vagues de chaleur, risque de feux sur l’ensemble du territoire, jusqu’à deux mois de sol sec par an. Il y a d’autres indicateurs de dégradation. A titre d’exemple, cet extrait du rapport de présentation du plan résume ce qui va devenir la norme : « En matière de température, l’année record 2022 deviendra à l’horizon 2100 une référence exceptionnellement fraîche tandis que des années plus chaudes de 2 °C à 3 °C en moyenne sont attendues ».
Si telle n’est pas l’intention des rapporteurs du plan, la présentation d’un catalogue de solutions d’adaptation montre mal l’ampleur du choc. C’est bien un choc qui nous attend. Il n’y aura pas de réponse administrative ni technique quand bien même il faut adapter nos institutions. C’est avant tout notre approche globale qui doit être repensée : c’est une démarche éminemment politique.
Le climat n’est pas une variable d’ajustement mais un élément structurel qui impose un changement de logiciel. Au-delà d’un aspect anxiogène, c’est la vie sociale qui va changer radicalement. Les manières de se déplacer, de produire, de consommer, nos rythmes quotidien, notre alimentation. Ne pas penser les impasses du capitalisme dans le dérèglement climatique, c’est s’empêcher de répondre aux défis qui nous attendent. Ce rapport prédictif est utile mais il fait l’impasse sur l’accélération du déni climatique avec un certain nombre de chefs d’Etats, dont la plus grande puissance du monde, qui abandonnent les objectifs de la COP15, pourtant déjà dépassés. Les marchés suivent sans contestation cette dérive inquiétante…tant que le business se poursuit. D’ailleurs, le symbole que constitue la baisse des émissions de gaz à effet de serre et la fin de l’utilisation des énergies fossiles ne sont plus un horizon à atteindre mais un vague objectif. L’agence internationale de l’énergie a rappelé que si les énergies renouvelables ont largement progressé, atteignant des records encourageants pour la décarbonation, les énergies fossiles n’ont toujours pas baissé. Les usages de sources d’énergie s’additionnent au lieu de se substituer au charbon et au pétrole.
Faudra-t-il réfléchir dans dix ans à un monde à +5°C au regard du déni climatique et de l’irresponsabilité du capital ?
De plus, nous ne pouvons pas faire comme si la situation se cantonnait à un traitement national. Comme le nuage de Tchernobyl, le changement climatique ne s’arrêtera pas à nos frontières. Il est à noter que rien n’est proposé dans les pistes de travail sur une coopération a minima européenne alors qu’on vante l’Union européenne comme la solution à tous nos maux. L’échelon continental serait pourtant utile surtout pour instaurer un système énergétique commun et partagé.
Le gouvernement fait le choix d’une économie de guerre en augmentant considérablement le budget de la défense, mais la meilleure dépense d’avenir, c’est celle pour adapter nos sociétés maintenant au changement climatique. Investir massivement dans la recherche publique pour créer les conditions d’une société juste afin de produire utilement nos besoins pour demain avec les limites environnementales qui s’imposeront à nous. D’ailleurs, la recherche doit s’accompagner d’un travail d’information transparent auprès de la population. Il n’y aura pas de changement de nos modes de vie sans débat démocratique pour partager les constats, les analyses et les solutions qui doivent être construites collectivement. Le fait que le gouvernement rechigne à publier le rapport annuel du Service des données et études statistiques sur les écosystèmes est à cet égard inquiétant : il faut donner à voir les progrès et les difficultés.
Il faudra gérer demain l’incertitude et la brutalité des évolutions climatiques. Il en va de notre santé publique, de notre qualité de vie. Sortir des impasses du marché : voilà ce qui ferait sens pour une vraie politique de justice climatique, d’une « Make our planet great again » comme le proclamait Emmanuel Macron en 2017. La France doit avoir une diplomatie active en matière de climat et ne pas laisser le terrain aux gouvernements climato-révisionnistes. Le fait d’accueillir une réunion d’étape cette semaine du sommet mondial pour les océans est une bonne démarche…à condition de s’engager à respecter les objectifs de préservation de 30% des océans et de ne pas soutenir la surpêche.
Il faut prendre en compte les inégalités existantes pour les dépasser car le dérèglement climatique sera très marqué socialement. Veut-on prévoir l’enfer pour la grande majorité et des îlots de fraicheur pour quelques-uns ?
Placer sous l’égide de biens communs les principales ressources et partager les savoirs en mesure d’adapter au mieux nos sociétés : voilà ce qui doit être la ligne directrice pour les êtres vivants puissent continuer à (bien) vivre sur cette planète, tout simplement.