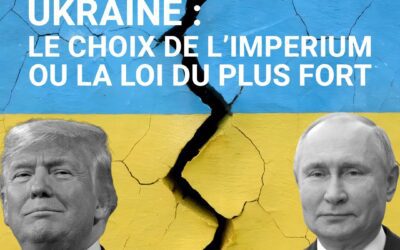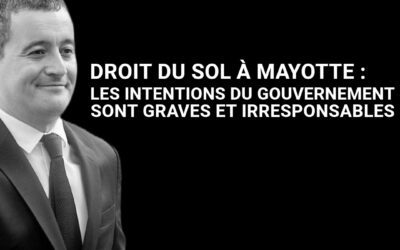C’est une des nombreuses guerres qui passent régulièrement hors des radars. La situation humanitaire est catastrophique depuis les années 1990. A la suite du génocide des Tutsis au Rwanda, c’est une guerre régionalisée qui s’est développé dans l’ex-Zaïre, redevenu République démocratique du Congo en 1997. On évoque plus de six millions de morts dans les divers conflits.
Avec des périodes de soubresaut et d’accalmies (trop courtes), le pays le plus grand d’Afrique australe tente malgré tout de se développer et de se doter d’institutions solides. Les régions orientales du pays restent un foyer de déstabilisations et de violences. Les récents événements font craindre une guerre directe entre la République démocratique du Congo et son voisin rwandais.
Depuis un mois, la rébellion congolaise du M-23 a pris le contrôle des régions administratives du Kivu dont la capitale régionale Goma. Soutenu par l’armée rwandaise qui est présente sur le sol congolais avec près de 4 000 soldats, le groupe sécessioniste crée de facto une administration parallèle à celle de Kinshasa. Des affrontements armés rythment cette région depuis près de trente ans et se sont intensifiés depuis 2009 au point qu’une mission de paix de l’ONU (MONUSCO) a été constituée. Les soldats de cette mission, qui accompagnent les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), ont été ciblés dans les récents affrontements avec notamment 13 soldats sud-africains tués par le groupe rebelle, créant de vives tensions entre l’Afrique du Sud et le Rwanda.
Cette guerre qui apparaît sans fin prospère sur l’incapacité à créer un cadre de sécurité collectif dans l’Afrique des Grands Lacs.
Le génocide des Tutsis au Rwanda a constitué un traumatisme puissant et laisse des traces dans les relations inter-ethniques entre Hutus (dont il subsiste des milices génocidaires en RDC) et les Tutsis. Cet événement majeur a contribué à reconfigurer les équilibres politiques entre Etats au point que le Rwanda est devenu le pont avancé de Washington qui en a fait une puissance militaire régionale.
Profitant de cette supériorité militaire, Kigali n’a eu de cesse d’interférer chez ses voisins au point qu’on peut parler d’un pillage systémique. Il est désormais établi par des ONG internationales que le Rwanda exporte du cobalt (120 tonnes par mois) et du bois pris sur le sol congolais par le biais de ses soutiens au M-23, l’intégrant à sa richesse nationale.
On pourrait s’en émouvoir et le condamner. Ce serait quelque peu hypocrite dans la mesure où tout ce qui concerne les minerais est au cœur de la concurrence mondiale. Personne n’a attendu l’activisme étatsunien de course aux terres rares pour soutenir une industrie extractiviste criminelle à tous points de vue (écologique, social, politique), symbolisée par l’expression de « minerais de sang ». C’est notre modernité technologique qui est en jeu ici. Des ONG ont d’ailleurs mis en lumière, par une action en justice contre les GAFAM, ces recels et crimes de guerre qui alimentent l’économie du numérique. Les Etats européens, dont la France, sont d’ailleurs hélas bien silencieux. L’échec de l’appel au cessez-le -feu porté conjointement par la Communauté Afrique de l’Est et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) démontre qu’il faut faire pression sur le Rwanda au-delà des Etats de la région.
La RDC est à l’image d’une mondialisation violente et insupportable. C’est toute la région qui subit d’autres crises dont celle d’un Etat failli qui se retrouve incapable de répondre aux besoins fondamentaux de sa population. La violence y est monnaie courante avec plus de 120 milices qui opèrent dans le pays mais aussi dans d’autres voisins tous aussi fragiles. Le pays souffre aussi des politiques d’ajustement structurel, des effets du réchauffement climatique qui fragilisent son énorme potentiel. C’est comme partout le développement humain et social qui sera la clé de résolution des problèmes de ce pays.
Cela implique surtout de construire une architecture de sécurité globale et de sortir des logiques de prédation par les multinationales.
Le peuple congolais, mais également ses voisins, ont le droit à la paix et à la sécurité comme l’affirmait le dirigeant indépendantiste Patrice Lumumba :
« A mes enfants que je laisse, et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu’on dise que l’avenir du Congo est beau et qu’il attend d’eux, comme il attend de chaque Congolais, d’accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté, car sans dignité il n’y a pas de liberté, sans justice il n’y a pas de dignité, et sans indépendance il n’y a pas d’hommes libres. »