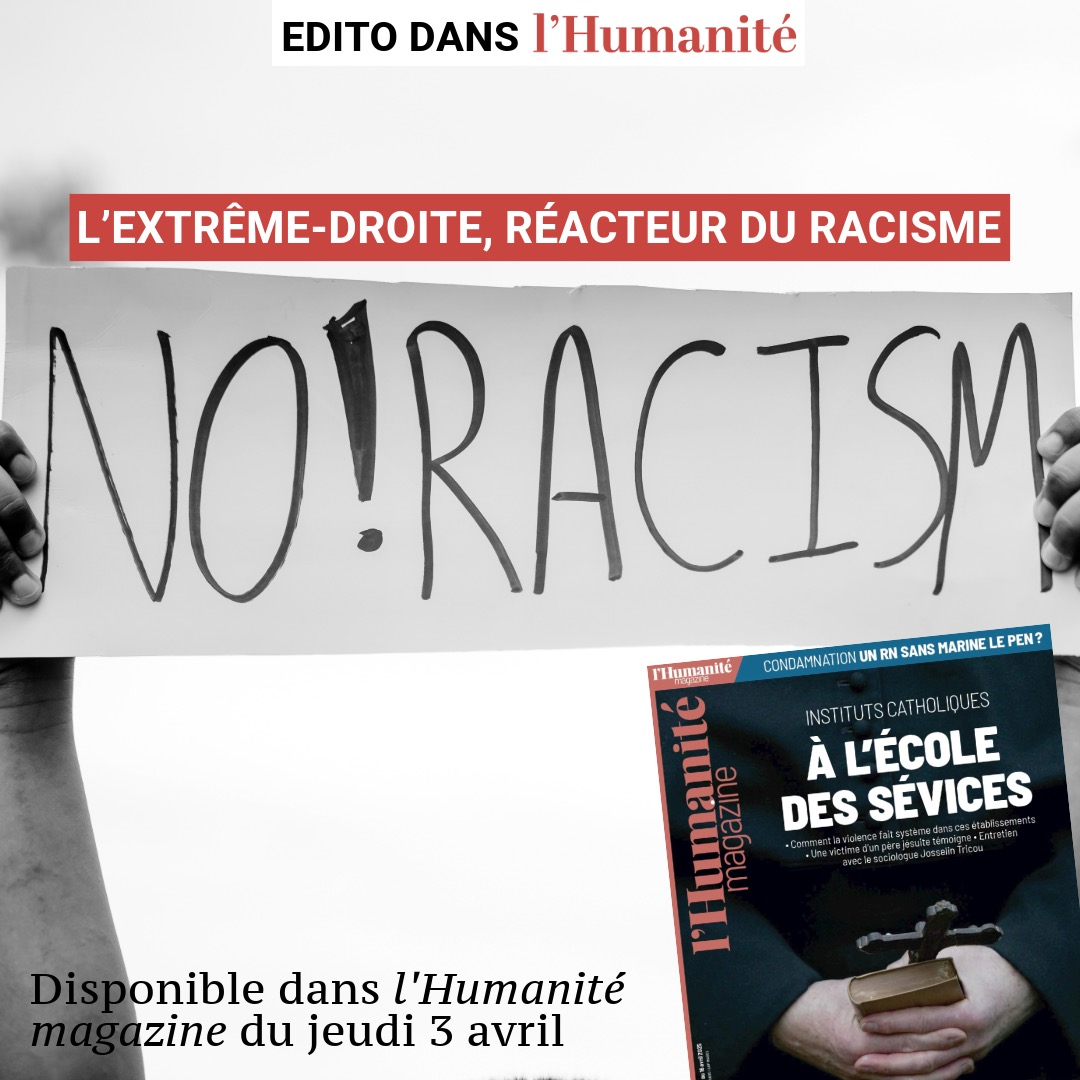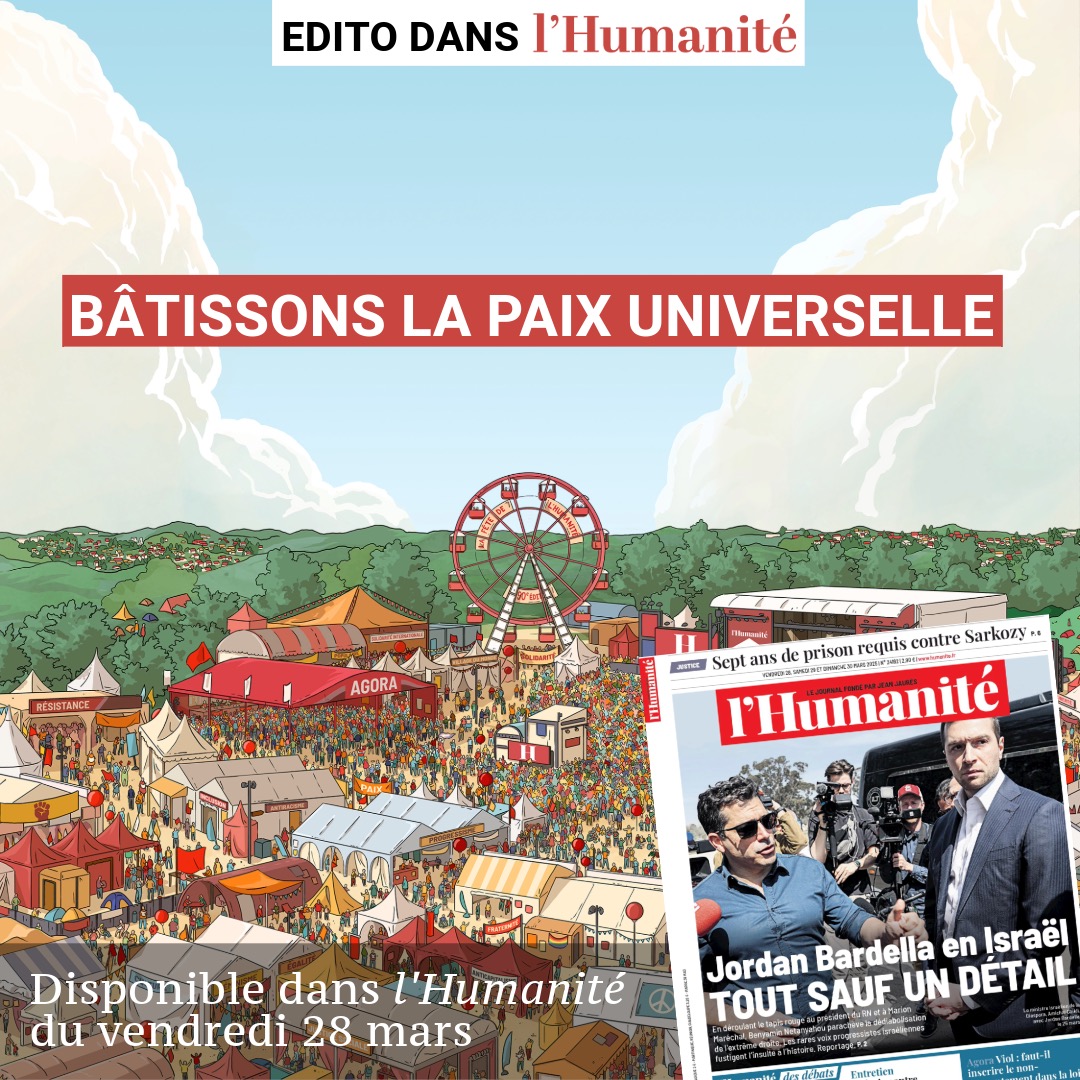Conférence au Sénat avec des parlementaires kurdes
Lundi, j’ai eu le plaisir d’accueillir au Sénat Madame Meral Danıs Bestas et Monsieur Sezgin Tanrikulu, deux député.e.s membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie pour un temps d’échange consacré à l’avenir politique des kurdes.
En Turquie, les kurdes sont victimes de discriminations systémiques et de violences d’état, qui se sont amplifiées depuis l’arrivée au pouvoir du président Erdogan, qui criminalise les représentants politiques de cette communauté.
Je pense notamment à Monsieur Selahattin Demirtaş et Madame Figen Yüksekdağ, actuellement incarcéré.e.s à de longues peines d’emprisonnement politique, ou encore trois maires du sud-est du pays, destitués arbitrairement en novembre dernier par Ankara, qui a placé sous tutelle ces régions administrées par les kurdes, et y multiplie la fermeture d’organisations politiques apparentées à leurs luttes.
L’acharnement du pouvoir turc à l’encontre du peuple kurde constitue une véritable négation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, malgré les annonces du président qui assure vouloir aller vers l’apaisement.
Cette matinée a également été l’occasion d’échanger autour de la situation géopolitique du Moyen-Orient, en plein bouleversement, dont l’avenir des Kurdes dépend, et de l’appel à cessez-le-feu du chef du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), Abdullah Öcalan.
Cet appel à déposer les armes est notable à l’heure où les logiques bellicistes et le réarmement militaire semblent être devenu la seule boussole des dirigeants.
J’ai donc tenu à rappeler que la condition d’une normalisation des relations entre l’Etat central turc et les populations kurdes ne pourra se satisfaire d’un simple arrêt des combats, et devra se baser sur la construction d’un système respectueux et égalitaire des droits et cultures de toutes et tous.
Cela, d’autant que les kurdes ont su, par leur organisation démocratique originale, faire de la défense des valeurs de progrès social, d’égalité femmes/hommes une matrice de leur projet de société, faisant démonstration qu’un Moyen-Orient pacifié, ouvert et respectueux de tous les peuples est possible.
Je tiens donc à remercier chaleureusement Madame Meral Danıs Bestas et Monsieur Sezgin Tanrikulu d’avoir fait le déplacement, et à Monsieur le Maire François Asensi de Tremblay-en-France, ville co-organisatrice de l’évènement.
Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Ce projet de loi proposait la transposition dans notre droit de trois directives européennes, pour répondre à la menace cyber qui est désormais une réalité en France.
En effet, les travaux préparatoires ont laissé apparaître que l’utilisation de logiciels malveillants verrouillant les données en échange d’une rançon sont en constante augmentation. Entre 2022 et 2023, il a été constaté +30% de ces actes, qui visent principalement les TPE/PME (34%) ou les entreprises stratégiques (10%), mais aussi les collectivités territoriales (24%) ou les établissements de santé (10%).
Ce texte poursuivait quatre objectifs principaux : compléter les définitions légales, clarifier les obligations des entités, éviter les différences de traitement injustifiées entre entreprises, et simplifier les démarches administratives.
Si ces problématiques sont cruciales, les propositions adoptées n’apparaissent pas à la hauteur des enjeux. Préférer la résilience à la souveraineté numérique, c’est condamner la France à une véritable dépendance aux entreprises étrangères en matière de cybersécurité.
Il y a quelques années encore, notre industrie était pionnière dans la conception et le savoir-faire de produits numériques à grande échelle ; mais les gouvernements successifs ont fait le choix de la désindustrialisation des secteurs des télécoms et de l’électronique grand public.
Les résultats de ces renoncements sont criants.
Loin d’être partie prenante de la révolution numérique en cours, nous sommes devenus tributaires des GAFAM, et prisonniers de systèmes d’exploitation, de solutions logicielles et de services cloud extraterritoriaux.
Et la politique gouvernementale ne tire aucune leçon de cette situation, en ne présentant qu’un plan de résilience peu financé, plutôt qu’une stratégie de réinvestissement de l’ensemble de la chaîne de valeur.
Pour tenter de reconstruire une véritable souveraineté numérique, j’ai déposé un amendement qui proposait de nationaliser le groupe ATOS, ex-fleuron français du numérique auquel nous avons consacré, l’an passé une mission d’information. Cette piste a été écartée sans débat de fond.
Loin d’apporter des solutions concrètes, ce texte acte une nouvelle fois notre dépendance aux GAFAM et aux entreprises étrangères pour assurer notre sécurité numérique. C’est pourquoi je me suis abstenu.
Commission d’enquête sur l’utilisation des aides publiques par les grandes entreprises et leurs sous-traitants
Cette semaine, nous avons réalisé 3 auditions dans le cadre de la commission d’enquête dont je suis rapporteur.
I – La première était conjointe entre Nicolas Bouzou, économiste et fondateur du cabinet d’étude économique Asteres, et Agnès Verdier-Molinié, directrice de l’IFRAP, un think-tank ultra-libéral dont l’indépendance a été très largement remise en cause dans un rapport récent de l’observatoire des multinationales.
Pour Nicolas Bouzou, le système français des aides publiques est dysfonctionnel, car les dispositifs se multiplient et nombre d’entre eux se révèlent peu efficaces. Toutefois, il considère que ce système est en place pour contrebalancer le volume et le poids des prélèvements patronaux et sociaux.
Il a également indiqué que le contrôle et le suivi de ces fonds était assez faible vu le volume des dispositifs, et a exprimé sa préférence pour un système qui privilégierait la commande publique.
Il considère que seules les entreprises qui respectent la loi française peuvent être éligibles à des aides publiques, quelle qu’en soit la nature. Concernant leur critérisation, il n’y est pas défavorable mais pense que cela devrait davantage relever du domaine de la loi, qui doit poser très clairement, en amont, les objectifs des différents dispositifs.
S’il s’est montré plutôt opposé à la publicité des montants des aides publiques par entreprises, il a reconnu l’intérêt d’un tableau de recensement interne à l’administration, qui permettrait d’accroître la lisibilité dans la trajectoire de ces fonds publics.
II – La seconde audition était avec la Direction générale du Trésor, qui a pour mission principale d’éclairer les politiques publiques en réalisant des synthèses de la littérature existante pour tenter d’avoir une représentation la plus fine possible des bonnes formes d’aides publiques à développer pour éclairer les conduites de politiques publiques.
L’auditionnée s’est déclarée favorable à un tableau exhaustif de suivi des aides publiques.
Concernant le calibrage des aides, l’auditionnée a considéré que les objectifs de ces dispositifs doivent être clairement identifiés, notamment en prenant en compte les défaillances de marché, sur lesquels l’Etat doit intervenir en priorité (exemple : les activités de recherche et développement).
Elle a souligné que les objectifs des aides ne doivent pas être trop larges : il est plus efficace de faire répondre un dispositif à un but précis, plutôt que de multiplier les critères.
Le montant de ces aides doit être le plus juste près possible des besoins, pour éviter les effets d’aubaine de certaines entreprises.
De même, sur l’évaluation, elle a mentionné quelques démarches sur des dispositifs spécifiques et s’y est montrée favorable de manière générale.
III – Enfin, la troisième audition était conjointe entre la Direction générale des finances publiques et de la Direction de la législation fiscale.
Ce temps a permis d’appréhender plus finement les mécaniques d’octroi et de contrôles des différents renoncements à prélever mis en place par l’Etat au bénéfice des entreprises.
Les grandes entreprises ont une direction de la DGFIP dédiée, qui concerne environ 56 000 entités, et a vocation à effectuer un suivi plus fin des obligations fiscales et de paiement.
Il existe deux systèmes. Le premier est dit intégré et relève du déclaratif puisque les entreprises indiquent simplement dans leurs déclarations fiscales l’ensemble des avantages fiscaux dont elles bénéficient. Le second suppose une demande expresse de l’entreprise, et concerne certains crédits d’impôts comme le Crédit d’Impôt Recherche.
Cette administration identifie les aides indirectes aux entreprises comme des « dépenses fiscales », à savoir un mécanisme fiscal qui s’écarte de la norme de droit commun et présente un caractère incitatif pour les entreprises. Si la mesure est purement technique, elle est dite déclassée et sort du champ des « dépenses fiscales ».
Un chiffre a été fourni : ces dépenses représenteraient 40 milliards d’euros sur 82 milliards au total.
Cependant, des données complémentaires doivent nous être transmises pour apprécier plus finement la part de ces 40 millions qui revient aux grandes entreprises, et celle qui est allouée aux ETI, TPE, PME.
Il est ressorti de l’audition une difficulté, non-imputable à l’administration, qui porte sur l’obtention de données chiffrées précises.